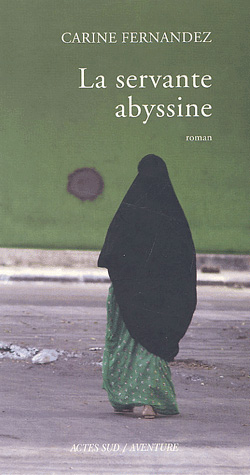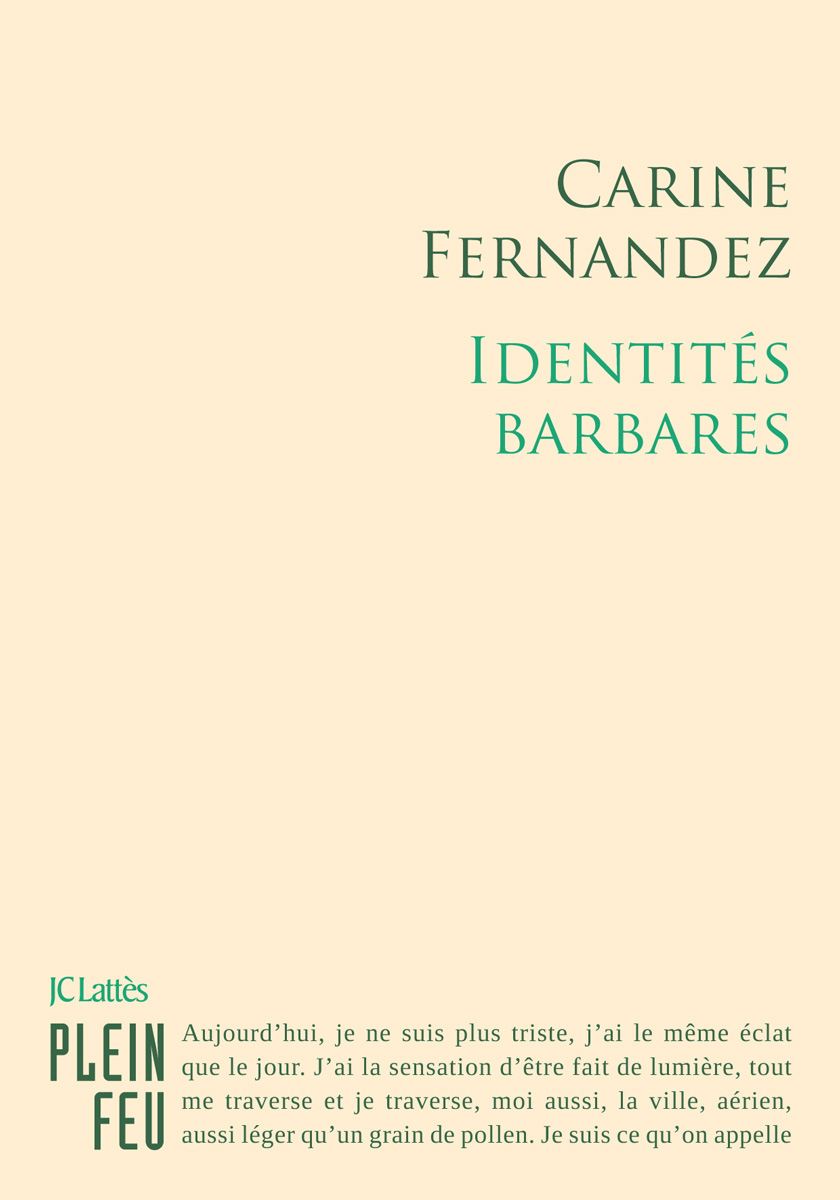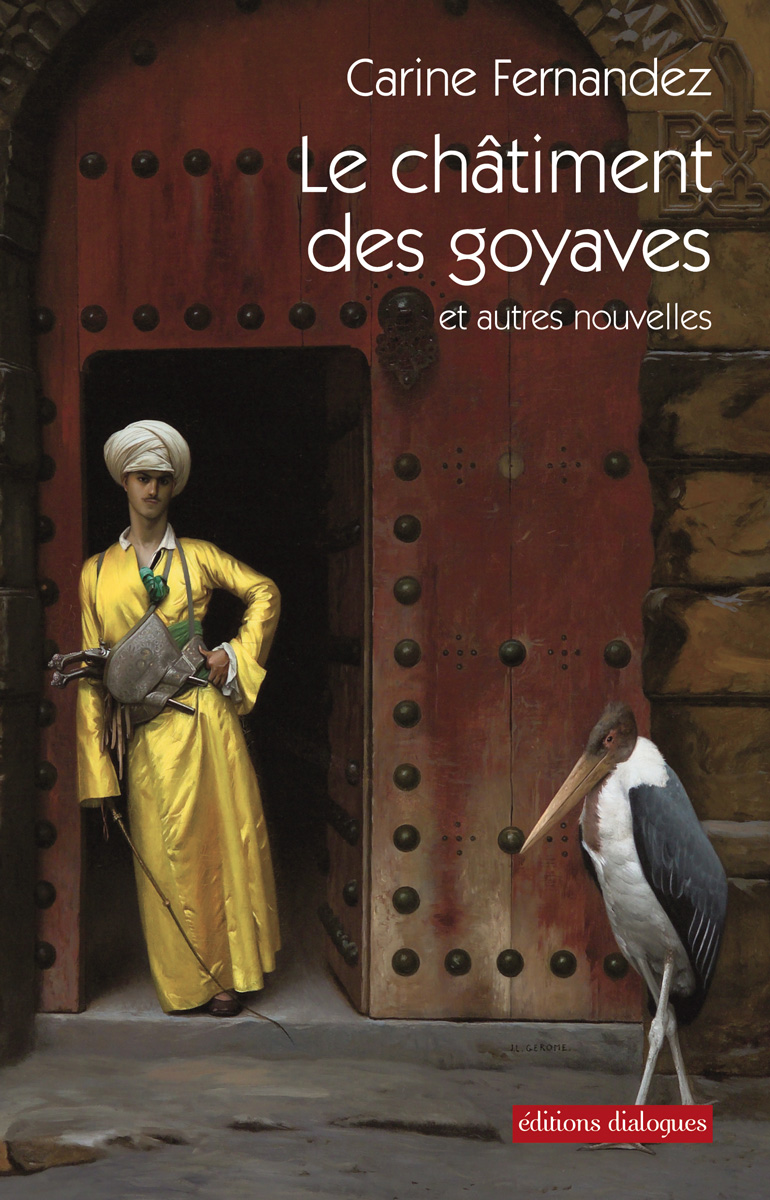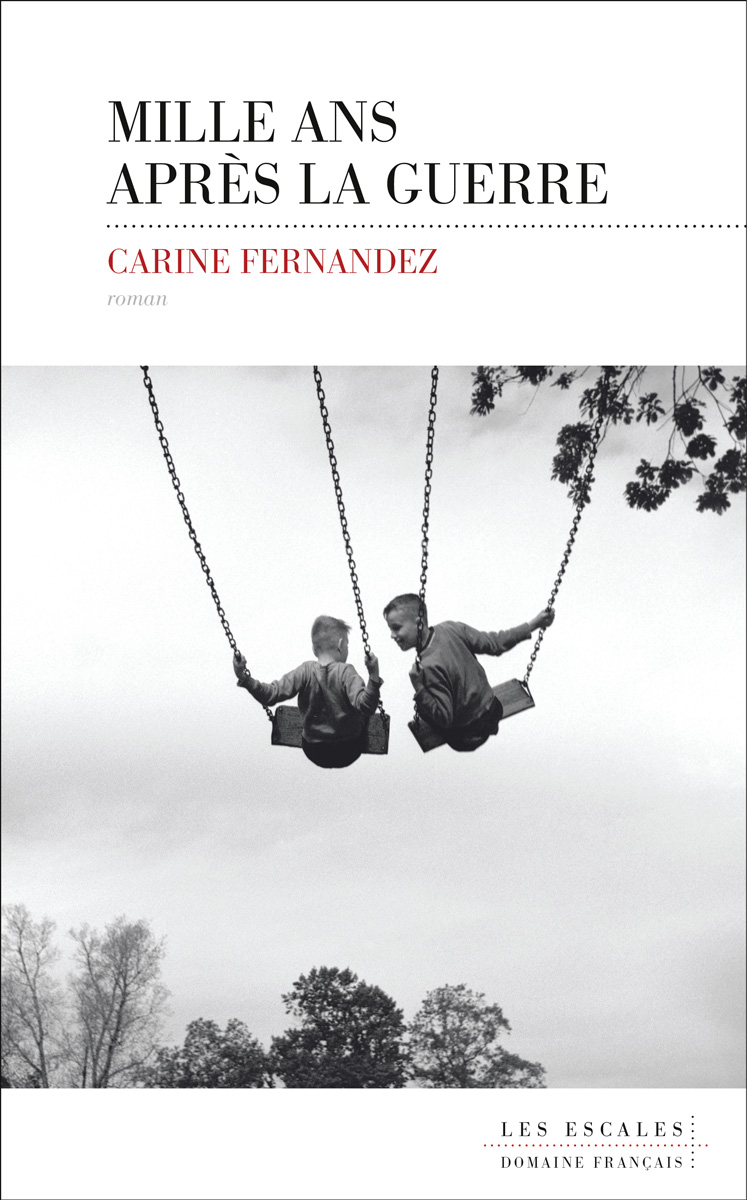Première partie
Elle n'était pas venue de Djakarta ni de Kuala Lumpur comme les modernes esclaves. Non, juste traversé la mer Rouge après huit journées de marche pour rejoindre Asmara et attendre deux ans et six mois le train jusqu'au port de Massaoua. Deux ans, six mois, huit jours, pour voir enfin la mer et respirer la chaleur suffocante de la plaine côtière. Même air, même mer pour eux les peuples squelettiques de la Corne d'Afrique, que pour les veaux gras du Hedjaz. Eux, les Erythréens, les Habbashs, la race noire aux jambes de sauterelles, on les traitait plutôt en voisins, ceux d'en face, contrairement à tous ces ventres creux venus de l'autre côté de la planète, là où la main de Dieu ne pourrait pas atteindre: Pakistanis, Hindis, Philippinos, Tahis, Indonesis. Si loin vers l'orient qu'ils en perdent couleur et forme humaine et passent et pâlissent jusqu'au teint malade et à la face plate de ceux qu'on surnomme ici les tamis à farine. Un raz de marée jaune sur l'Arabie, une invasion de Jawas. Voilà ce que c'est devenu. A croire que le pays s'effondrerait, les femmes saoudiennes se jetteraient à la mer toutes ensemble avec leurs marmots accrochés à leurs voiles, leur matrice sûrement gonflée d'un petit dernier, si on leur supprimait les petites mains asiatiques: celles de la cuisine, du repassage, les chauffeurs et les nannies pour laver, nourrir, torcher, bercer les nourrissons frais pondus de l'année lunaire.
A l'époque où Zinesh débarqua à Djeddah, dans les années 1970, on était encore loin de ce grand charivari oriental. On distinguait trois couleurs, le noir pour le travailleur africain, le brun pour l'Arabe, très peu de blanc, une touche ici et là qui se risquait parfois hors des ambassades. Elle était arrivée avec le visa de la princesse Kalthoum, cinquante autres gueux de son espèce, ouvriers ou domestiques, transbahutés pêle-mêle dans le même chargement maritime, mains noires à tout faire et malhabiles comme des mains gauches. Ils s'y feraient bien assez vite. Ils appartenaient maintenant à la princesse. L'époque était honnête, pas de supercherie. On les recrutait en Erythrée pour un membre de la famille royale et c'est dans un quelconque de ses palais qu'ils travailleraient.
Les premiers mois on la mit aux cuisines. Aux cuisines, pas à la cuisine. Pour cela la princesse avait son chef français et plusieurs sous-toques egyptiennes. On l'assigna à la plonge, à gratter le cul des marmites, le temps qu'elle apprenne l'arabe car elle ne parlait qu'amharique et italien. En moins de temps qu'il n'en faut à une volaille pour couver ses oeufs, elle baragouina l'arabe basique, quelques phrases d'anglais et du français de cuisine. Elle avait toujours eu l'esprit agile. En quelques mois elle rattrapa ses maîtres se fit le singe de leur langage, leurs usages, et leur manière de penser. Ce fut là son école, elle y gravit tous les degrés jusqu'à en devenir une irréfutable parleuse, une "je sais tout" de première force. Comme un cactus les traces d'humidité, elle aspira, sans qu'il lui en coûtât, tout ce qui passait à sa portée, ce qui s'apprend et même ce qui ne s'apprend pas: l'élégance! De quoi se consoler d'être sortie un peu vite de l'autre école, celle des cahiers gris. Elle y serait restée plus longtemps, elle y aurait fait merveille. C'est ce que lui disaient les soeurs italiennes de la mission qui voulaient la garder au moins jusqu'au brevet. Ah! d'une bien drôle de façon on la fit communier le printemps de ses quinze ans. Ses parents la donnèrent à Zaccaria son cousin. En bonnes et justes noces, il leur avait payé trois vaches, une dizaine de tanika de beurre fondu et quelques pièces de cotonnade pour elle, rien que pour elle . Zinesh n'avait jamais rien possédé de si beau! c'était un homme droit de corps comme de coeur. Il lui entrait tout droit dans le ventre chaque nuit et elle s'en trouvait, il faut le dire, fort bien. Elle en venait même à l'agacer sous son pagne s'il oubliait de la chahuter un soir de fatigue. C'est dire si les filles deviennent vite de franches goulues de cette chose, qui effrayait les soeurs comme des bataillons de démons.
Quand Zinesh quitta l'Afrique, elle avait connu quinze ans de mariage, une fille lui était née, c'était une femme accomplie, mais elle n'avait plus rien. On ne l'aurait pas fait parler de cela. A quoi bon! Elle n'avait même pas de photos de la petite. Qu'on ne croie pas son sort pire qu'un autre, sacrément mauvais, ça oui. Avec toujours ces fournaises béantes où il faut bien plonger. Mais elle allait toujours de l'avant, elle n'avait jamais fui devant le danger. Zinesh, Habbashia et Messiia, chrétienne d'Abyssinie. Quand elle se reportait vingt années en arrière, au moment de son arrivée en Arabie , elle se trouvait moins brute et ignorante que les autres. De la finesse et du jugement, mais tout de même, tant de chemin restait à faire! Patience! Que dit-on des pierres précieuses avant qu'on ne taille leurs arêtes? Cailloux! De terreux et opaques cailloux aux veines lentes. Elle voulait se souvenir de cette époque où elle était encore caillou.
Zinesh était partie de son plein gré. Elle n'avait pas été vendue en esclavage, comme ses tantes et ses oncles à un négociant négrier, de ceux qui passaient par les villages, il y avait à peine quarante ans. Quand les sauterelles avaient dévoré toute la récolte et qu'on ne pouvait régler l'impôt au Mangest, on se défaisait d'une ou deux femmes, d'une poignée de gosses. Les négociants du Hedjaz ou du Yémen choisissaient les plus clairs et les plus vigoureux. On l'aurait achetée un bon prix, car elle avait la couleur cuivrée du thé au lait et le nez fin. De nombreuses maîtresses arabes à la peau fumée comme des jattes à four en prirent ombrage et lui firent payer d'être une Noire trop blanche. Elle n'en tirait pourtant aucune vanité. Toutes les femmes de son village n'avaient-elles pas cette même coupe de visage, un bel ovale, pur comme une goutte d'huile? C'était la marque de la terre, tout simplement, de même que tel versant bien exposé donne les meilleurs caféiers. De plus, elle n'oubliait pas ses dents trop écartées qui l'empêchaient de se dire belle, ses larges palatales, espacées d'un grain de riz, qui lui conféraient un sourire d'écolière.
A la différence de ses proches ancêtres esclaves, on n'avait rien donné pour avoir le droit de la prendre, c'est elle qui avait déboursé à l'agence de recrutement d'Asmara afin que le visa lui vienne et que le bateau l'emporte. Elle était donc une femme libre comme tous ces domestlques qu'elle allait voir battus, violés dans les palais de marbre.