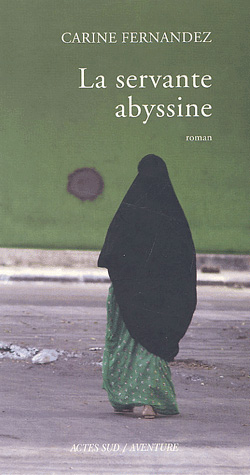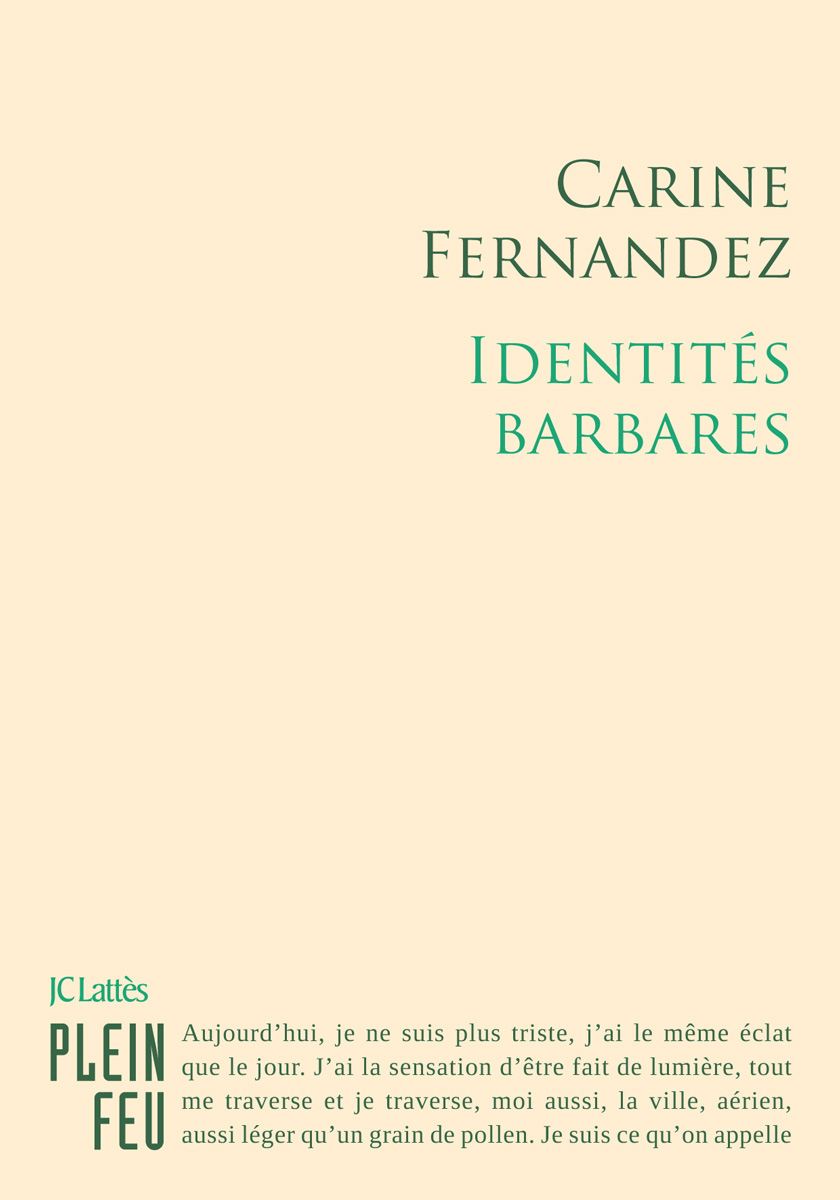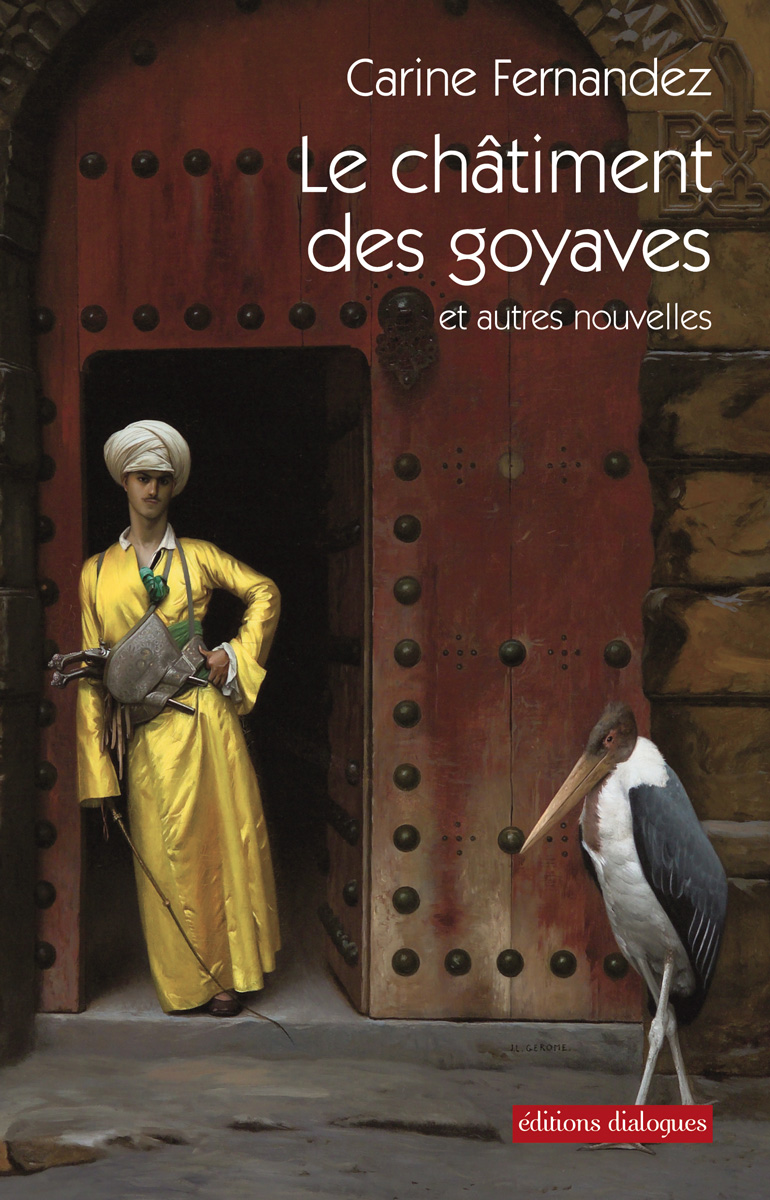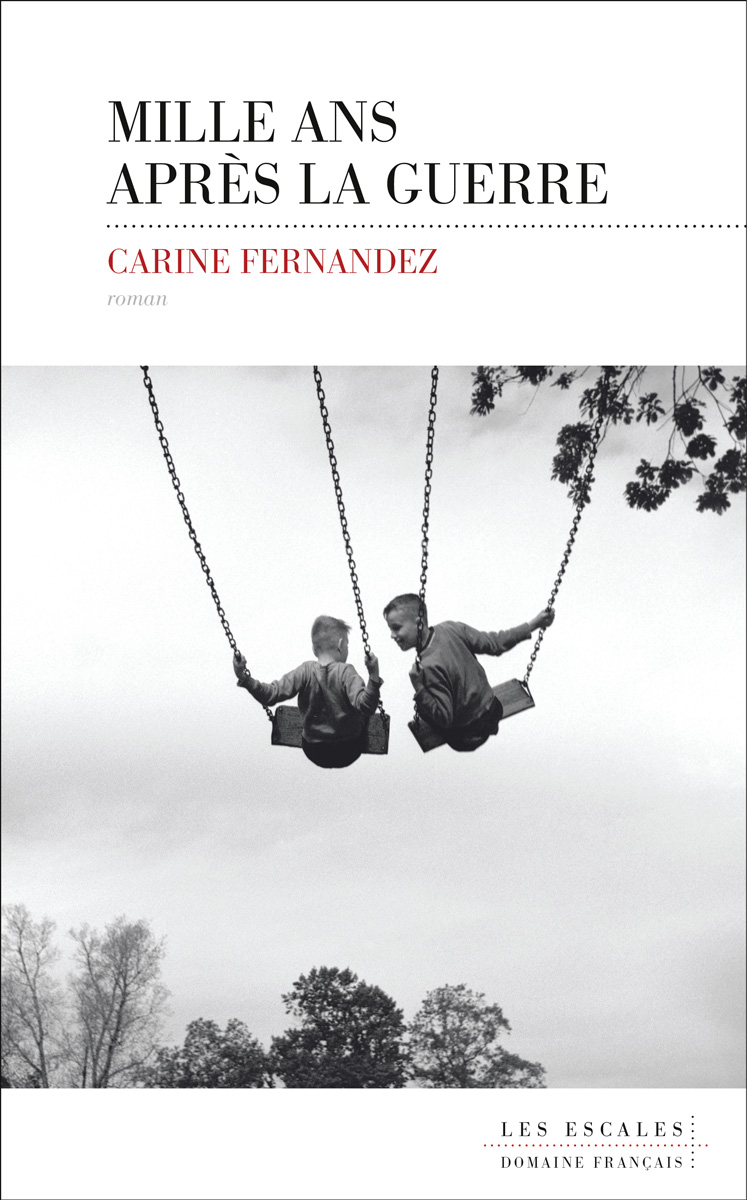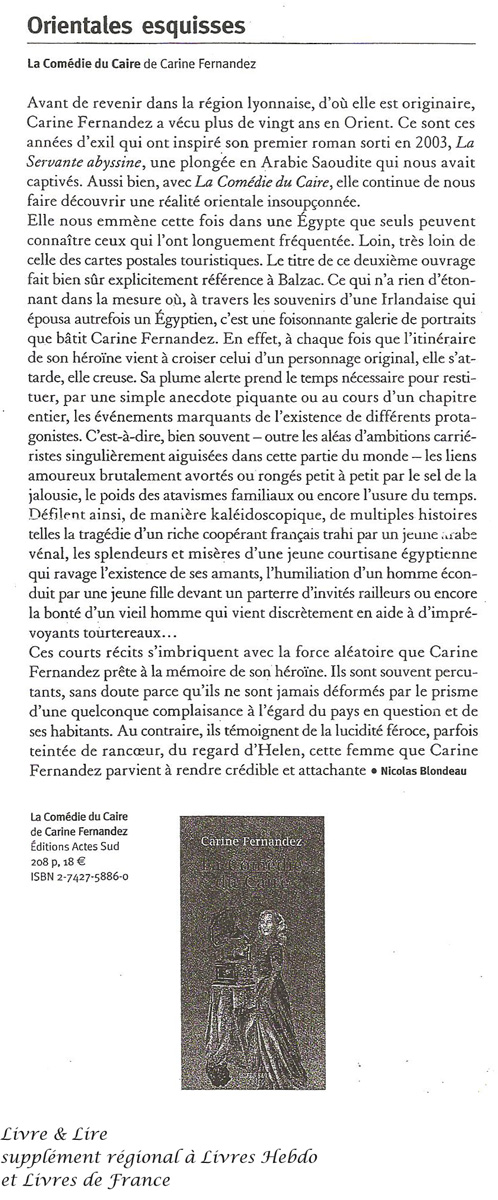Cliquez pour agrandir
 La saison rouge
La saison rouge
Actes Sud, 2008
Qatan, un pays arabe fictif. Dans l’univers carcéral de sa maison promise à la démolition, Elisa, une jeune Européenne délaissée par son mari, isolée avec son fils, devient folle de solitude.
Huis clos oppressant avec, pour seul interlocuteur, Pascual, le serviteur philippin, tandis qu’un étrange jardinier yéménite épie du haut des palmiers.
Des jours, des semaines à attendre, à se consumer de jalousie, sans nouvelles de Hatem, l’époux insaisissable parti en voyage d’affaires en Europe. Mais peut-être n’a-t-il pas quitté la ville… car le riche royaume de Qatan est un piège, un tyrannique pays de la nuit, où les hommes peuvent du jour au lendemain disparaître.
Au milieu du champ de ruines de son attente interminable, les réminiscences de l’année nubile, de l’ivresse du départ vers l’Orient, de l’amour fou, reviennent hanter Elisa.
Dans une écriture où la sensualité lyrique cède progressivement le pas à un ton sobre, parfois cruel, Carine Fernandez nous donne un roman implacable, comme une tragédie. La Saison rouge est certes une fiction – mais le désespoir, la solitude, l’effroi qui gonflent les pages ont la puissance que seul a pu insuffler le réel. Et si ces “démons et captifs” ont toutes les chances de s’inscrire sur les rétines de la mémoire, on aura surtout du mal à oublier cette femme traquée, l’étrangère sans voile, isolée dans sa maison des sables, jusqu’à la folie.
Première partie
UNE HIRONDELLE AU DÉSERT
J'ai écrasé la guêpe sur la vitre avec le conte arabe. Frappe! Le petit corps est resté collé de tous ses sucs, a perdu ses limites sacrées. Le rideau s'immobilise. Je m'étonne de mon ridicule tremblement intérieur : crainte de la piqure, horreur d'avoir tué, contentement et honte d'avoir connu la peur que provoquent les dangers mortels et d'y avoir répondu avec un même courage, celui avec lequel on sauve une ville ou on court sous les bombes.
Une couleur pourpre inonde le ciel, comme un drapeau ensanglanté. Dans un instant il fera nuit, pas dans une heure ni dans vingt minutes, non, tout de suite, le temps de refermer la fenêtre. Déjà le vent du soir agite les palmes des dattiers qui griffent, avec un bruit métallique, le dos des climatiseurs saillant de la façade en verrues grises. Sortir dans les rues chaudes, aller chercher du lait à l'épicerie voisine, impossible. J'attendrai demain. Une nuit à passer jusqu'au premier appel à la prière.
Une nuit à attendre dans le silence. Plus de musique, non, plus de musique ! La stéréo est muette, condamnée à blanchir sous la poussière. C'est que tout lasse, et la musique, après avoir percé l'âme ou fait crever les souvenirs comme de vieux abcès, les sclérose, couvre le coeur de corne, cette épaisseur de l'habitude et des airs qui ne riment plus à rien. Je ne veux entendre que les bruits du silence. Le portail de la villa voisine qui claque et une voix qui crie dans la nuit : "Qui est- ce ?" les chats rôdeurs étripant les poubelles et la dégringolade attendue ; et ces pneus qui crissent à vous écorcher les oreilles : le rodéo de la jeunesse du royaume de Qatan qui fait des freins à main sur les terrains vagues à la tombée de la nuit.
Je suis la femme seule, l'étrangère sans voile, qui ne cache pas son visage, aux jolis traits, mais dont on se détourne pourtant avec malaise, son visage aux yeux vairons. On doit penser que c'est la marque du diable : un oeil bleu, un oeil vert. L'un des deux est le mauvais oeil. Lequel ? Certainement le vert où dansent des paillettes de malice. Du coup, l'interlocuteur me parle du côté droit, me voudrait de profil, essaie de capter uniquement l'oeil bleu, l'oeil candide. Ici tous les iris sont noirs comme ceux de Hatem. J'ai tellement aimé ces yeux de lave durcie, sans transparence, mais profonds, des yeux humains, des yeux de passion, pas des yeux de chat. Les miens sont deux agates dépareillées qui ne provoquent que la curiosité ou la répulsion. Heureusement le petit a les yeux arabes, il pourra vivre ici, on ne le dévisagera pas comme une bête étrange : fils de la femme blanche au mauvais oeil.
Mais Hatem est parti, une fois de plus. Il m'a laissée seule avec le petit. Il m'a attirée dans son pays puis m'y a abandonnée; lui connaît les avions et les capitales d'Europe, il est l'insaisissable, l'homme libre; moi, la captive.
Je reste donc avec mon fils Rami dans le royaume, à l'intérieur duquel j'ai circonscrit mon royaume. La maison est située au centre de Qatan City, dans la vieille ville, un centre oublié, qui n'intéresse plus personne, tant la capitale a poussé, à la conquête du désert ; abandonnant ses rues à arcades et les galeries de ses souks, pressées autour du fort Toureyb, dans une course effrénée aux avenues bordées de gratte-ciels ou de palais. Ville d'Orient où nul ne marche. Le comput n'est pas le pas humain, mais le mile dévoré par les voitures américaines.
La maison est au centre, c'est une bonne maison, avenante, qui n'a pas la froideur de catafalque des prétentieuses villas de marbre que l'on construit de nos jours. Je l'ai tout de suite aimée, je l'ai aussitôt élue. En cinq ans dans la capitale, j'ai déjà déménagé plusieurs fois. J'essayais, mais rien ne me convenait. Il me fallait pourtant trouver la maison, le refuge où tisser ma toile, car à l'extérieur, dans le royaume, on ne vit pas.
Il n'y a plus de passants, plus de rues, que des routes, des avenues interminables à double voie et la gueule ouverte du désert où les étrangers disparaissent, se font parfois tirer à la kalachnikov. Il arrive qu'on en soit informé. Mais la plupart du temps on n'en sait rien. Le ministère de la Culture et celui de l'Information ne font qu'un: département de la censure.
J'aurais aimé vivre dans une tour, mais une tour à moi seule, pas un de ces gratte-ciels avec dix ascenseurs qu'il faut partager avec des voisins au regard d'embuscade, comme ce premier appartement du quinzième étage, lors de mon arrivée à Qatan. C'était un meublé moquetté gris, aussi fonctionnel qu'une administration et dont nous étions les premiers locataires. Nous étrennions les meubles dans un parfum de bois vernissé, de mastic frais et de chintz neuf. Derrière la paroi vitrée, Qatan se déployait, semblable à une monstrueuse amibe brune.
J'ai passé trois mois à la contempler du ciel, cette capitale des sables. Les minarets pointant leurs croissants dorés entre les immeubles : d'étranges vaisseaux spatiaux couleur d'ébène, d'autres hérissés de verre, qui s'irradiaient au soleil comme des quartz gigantesques, et ce roi des gratte-ciels, ce cyclope à la façade percée d'un O, un oeil unique par où s'engouffrait le firmament de Qatan.
Elle me laissait ahurie, mal à l'aise, cette Métro- polis toute verre et acier bleuté. Elle me semblait déplacée, transplantée par mégarde au milieu du désert où des peuples nomades avaient vécu hors du temps, au rythme des lunes et des étoiles, n'avaient presque rien édifié. Leur trace jusqu'à ce jour si légère sur la terre. Les restes des campements chantés par les poètes bédouins des sept Mu'allaqat: une poignée de cendre, quelques noyaux de dattes.
Sans ces premiers mois passés au quinzième étage de la tour, je n'aurais jamais su à quoi ressemblait la ville. J'ai depuis logé dans diverses villas, caisses aveugles, hermétiques comme nos cercueils d'Europe. Ici le mort est libre : un simple linceul de toile avant le linceul de sable, la gangue blanche de la graine qu'on met en terre, ici, seuls les morts ne sont pas enfermés.
Je suis passée d'une maison à l'autre, des villas monumentales, construites pour des tribus, des enfilades de pièces vides. Et des murs, des murs... Chaque villa: un immeuble où l'on aurait logé dix familles à l'aise. Ce n'étaient qu'enceintes hostiles, sans fenêtres, sans terrain, des citadelles jumelles cerclées de murailles hautes de trois mètres. On aurait dit des navires trop gros, coincés dans des écluses. D'en bas on ne voyait que des parois.
Mais désormais l'espace que mon regard embrasse dans l'enclos de ma vieille villa du quartier de Mounira me suffit. Je la dis vieille, car à Qatan, si les constructions jaillissent chaque jour du désert, elles y retournent aussi vite, et en moins d'une génération une maison est plus vétuste qu'en un siècle en Europe. Ma villa est donc une antique bâtisse, édifiée au premier âge du royaume, dans les années 1940. Qu'est-ce que je fais ici, à part tuer les guêpes, tuer le temps? J'attends et la maison est juste assez ancienne pour partager cette grande patience.
Elle a des allures de bateau, mais de bateau de haute mer bataillant sur les flots, une carcasse hérissée de la citerne d'eau, telle une cheminée disproportionnée coiffant cette construction bizarre, ignorante du fil à plomb. Ni jeune ni vieille, ni belle ni laide, comme la Pandora de Nerval, une ensorceleuse. Et elle m'a envoûtée très certainement avec sa patine beurrée, ses dénivellements capricieux d'une pièce à l'autre, ses vérandas aux maçonneries à jour aux formes trilobées qui lui donnent l'aspect d'une vieille fille jaunie sous les dentelles. Elle possède de grandes fenêtres et des volets verts, pas des fenêtres en aluminium et des volets roulants, non, des volets de bois que j'ouvre chaque matin sur le jardin, un vrai jardin, avec des palmiers dattiers adultes qui rappellent l'époque où Qatan était une palmeraie ceinte de falaises pourpres.
C'est une maison d'un étage, un caprice architectural, qui aura poussé au gré des besoins des familles, avec autant de décrochements en terrasses qu'une petite médina, des dizaines de pièces, inutiles, qui demeurent fermées, celles du rez-dechaussée me suffisent. Qatan est le pays du superflu et de l'outrance; sur six salles de bains aux tuyauteries rouillées, une seule fonctionne à peu près. Et les portes d'entrée! Il y en a trois, trois panneaux de fer gris comme des portes d'usine, la principale qui donne sur la véranda, puis celle de gauche, la porte des femmes qui s'ouvre sur le jardin, enfin celle de la cuisine, face au petit bâtiment presque à l'abandon qui sert de remise et de buanderie.
Une maison où nul ne vient, où seules se font écho ma voix et celle d'un petit garçon de sept ans. Cette maison est mon unique bien, mon domaine et ma protection, et, aussi étrange que cela paraisse, elle est mon espace et ma liberté. J'arrose chaque jour le jardin, comme si l'odeur de la terre mouillée montait des vallées du Yémen ou des palmeraies d'Egypte. J'existe ici dans ce coin de Moyen-Orient, sur quelques arpents de désert, tandis que je ne suis même plus un souvenir en Europe. Là-bas, chez moi... je suis effacée des mémoires. On m'aura oubliée. Tant d'années sans donner de nouvelles. Je ne compte plus pour personne. Encore un pas de plus vers l'anonymat, la non-existence, et je deviendrai une de ces formes voilées de noir que le vent gonfle. Sans visage, sans identité. J'en frémis de honte et de dégoût.
Est-ce à cette solitude que j'étais destinée? Comment ai-je pu me laisser prendre à ce piège? J'étais pourtant toute ferveur. Une amoureuse. J'étais l'amoureuse. Malgré mon jeune âge et mes yeux vairons - à cause de ces terribles yeux dépareillés -, je devais aimer comme on se tue. J'avais donné ma vie sans retour.
2
J'avais foutu le camp à seize ans, à l'âge où l'on part vers la couleur. C'était l'Orient qu'il me fallait. L'Orient et l'amour pour mon avidité d'adolescente. J'avais quitté Lyon, ma ville natale, ses brumes, ses ivrognes, ses crottes de chien traîtresses sur les pavés et son lycée caserne. Je fêterais mon seizième anniversaire à Rijeka, au dixième étage d'un hôtel de tourisme des années Tito avec du champagne russe et une baignoire ensanglantée des roses rouges achetées l'après-midi même à une vieille au profil de sorcière, dans ce qui s'appelait alors la Yougoslavie. Sans un regard en arrière, Elisa. C'est ainsi que l'on fugue.
Le destin, pour l'aérienne fillette qui séchait le collège, prit le visage de l'unique spécimen qatani. Hatem était l'Orient et, au-delà, il était l'Inde, par sa chevelure drue et lisse comme une herbe, par son odeur myrrhe et cardamome. Je ne connaissais pas plus l'amour que le royaume de Qatan, de cela aussi, il faudrait me dépuceler.
C'était la folie verte du printemps. Le trop de sève qui fait courir le lierre et les fourmis sur les vieux troncs, qui soûle les abeilles aux grappes de glycine, lorsque les jours rallongent tellement qu'on marcherait sans rencontrer la nuit. Un de ces jours d'éternité, nous avons pris la route pour l'Orient. La plus belle des échappées vers l'Est, par le Mont-Cenis, Venise, Trieste et la Yougoslavie, journées de mai sur les routes bosselées du Monténégro, l'an 1971.
La route... elle file encore dans ma mémoire, cette route unique dans laquelle se prolongent toutes les routes du monde, ses lacets noirs me serrent la gorge, quand je sais qu'elle continue de tenir, pour d'autres, toutes ses promesses de liberté.
Au milieu de mon désert, dans la citadelle de ma mémoire, montent des voix étrangères qui ont pourtant la familiarité du passé, un anglais de tax-free shop et de réception de palace, vulgaire, la voix liquoreuse de la pute autrichienne, la plus belle femme du monde - et chaque réussite incontestable de la nature n'est-elle pas un sommet au pied duquel tout le reste se retrouve aussi plat qu'une bouse? -, la plus belle femme du monde, sûr, tout en jambes, fusant d'un short microscopique, et en seins véritables, on n'était pas encore à l'époque pneumétrique des tours de poitrine apocryphes, du coussinage siliconé et des Wonderbra. Miss Hilda ne trichait pas, sauf pour ses cheveux qu'elle détestait, du blond fadasse des gardeuses de porcs tyroliennes, désormais teints dans un noir despotique.
La ferai-je remonter du maelström du temps et du premier été à Beyrouth, l'impudique Hilda et ses petites amies anglaises avec lesquelles ça feulait de concert dans la chambre aux douze miroirs et au sol d'angora rose "cuisse de nymphe" pour la plus grande jouissance de son protecteur du moment, un magot quadragénaire de nationalité qatanie. Hélas ! le beau-frère de Juliette ! Hélas ! le frère de Roméo, vingt ans et quelques vices coûteux de millionnaire en plus, le nabot à bedon qu'elle asseyait sur ses genoux de putain magistrale pour lui labourer, vilaine, son occiput chauve de ses ongles pareils à ces bigorneaux qu'on appelle "couteaux"?
Oh! mais si on laissait seulement remonter Miss Hilda l'Autrichienne, gare! car elle ne viendrait pas seule. Accrochés à ses bottes de skaï blanc, toute la maisonnée, tous ceux étranges, riches, inconnus jusque-là, tous hôtes de ce castel doré à l'or fin, suspendu en plein ciel au- dessus de l'été et de la mer intense où le venin de la guerre civile, dans l'amertume des varechs, attendait. Trois étages de faux Schönbrunn, lui- même faux Versailles, au sommet du plus étincelant building, rue Verdun, le tout calotté d'une piscine et d'un jardin méditerranéen. Il me suffisait à moi, petite, d'emprunter l'escalier à la maçonnerie ajourée sur la terrasse ouest, j'étais dans l'eau qui déleste les corps, dans l'ombre sucrée des figuiers et la volupté du jasmin étoilé. Ah! jamais ne fut corps plus glorieux, plus luminescent, plus riche de phosphores que ce petit corps lisse et blond de seize ans! Et je te roule dans le chaud, de l'or tiédi, et je te plonge dans le frais, aigue-marine qui perle sur la peau! Après les baisers de la nuit, les cavalcades amoureuses de la sieste, mon corps sacrificiel, purifié, dans sa verdeur passionnée. Innocence! Oui, alors j'étais Eve, la vivante.
J'étais très pauvre en ce temps-là, ces trois mois durant lesquels je fus l'invitée honteuse du beau- frère millionnaire. Entre les festins monstrueux pris à la table de la belle-famille où je ne touchais à rien, paralysée par cette humanité riche et arabe et ces filles d'Europe cotées dans les night-clubs de Beyrouth, je grignotais dans le secret de ma chambre Pompadour des pains au lait et du chocolat achetés deux lires à l'épicerie du coin.
Comme dans les romans de Henry James ou dans les sagas du roman populaire à la française, mon histoire comportait des domestiques, un cuisinier, deux femmes de chambre, un chauffeur gris métallisé, livré probablement en option avec la Jaguar, et une standardiste de vingt ans, fourguée à la réception du rez-de-chaussée, juste assez ravissante et potelée, dans son entrelacs de fils rouges et d'yeux électriques clignotants, pour se faire peloter par les visiteurs à braguette.
L'oeil des domestiques! A cet oeil on ne la faisait pas et je le savais moi aussi d'instinct. Ils m'avaient vue venir avec ma paire de sandalettes, mon absence criante de bijoux, ma gaucherie à table ; je n'étais pas de la race des maîtres. Ils ricanaient sur mon passage, clignaient de l'oeil avec ostentation pour railler mon défaut, m'avaient sans doute, dans leur amour des hiérarchies, assigné un rang bien plus bas que les putains de haute volée qu'on croisait ici dans les couloirs. Pour moi personne ne payait. Qui aurait voulu d'un si joli monstre aux yeux vairons? La mascarade du maazoun ne leur en avait pas imposé, loin de là! J'étais la seule bluffée par la surprise qu'avait préparée le maître. Il avait fait venir un saint homme, un mamamouchi au turban plus ample qu'un trente-trois tours.
Un mariage, l'acte de civilisation par excellence ! Même chez les peuplades les plus aborigènes, les plus bochimanes, les plus mesquitos, l'ordre c'est le mariage, la distinction entre le rut bestial et le rut enfin social. La rédemption de l'espèce! Le besoin du coït sanctifié, avec le prêtre, avec la fête et les parents et les témoins qui signeront et parapheront bien qu'ils ont vu! Qu'importe si on épouse pour un mois ou même un week-end musulman, il suffit d'appeler "dot" le prix de la passe. Tour de passe-passe...
Ça l'émoustillait, le titillait, l'émouvait presque d'une façon niaise et perverse, le nabab nabot. Il se moquait bien de l'interdiction parentale, lui, le frère aîné, et nous marierait le jour même, et en profiterait pour convoler lui aussi par la même occasion. Depuis deux jours il avait souffert un véritable cas de conscience: choisir dans son harem informel, décider de laquelle des trois ou quatre oiselles ramenées d'Europe il ferait sa nue propriété le temps d'un été ou d'un peu plus, peut-être. Beyrouth l'avait surnommé Haroun al- Rachid - de quoi le rendre plus fier qu'un rat sur son fromage - pour avoir déjà répudié six épouses: deux Egyptiennes, une Anglaise, trois Autrichiennes; la Qatanie choisie par les parents au sortir de la puberté ne comptait pas. Il ne baisait que de l'importé. Il avait finalement opté pour la plus jeune, Greta l'Allemande qui l'avait séduit par sa manière printanière de lui faire glisser l'embauchoir lorsqu'il l'avait rencontrée dans une boutique de chaussures à Francfort au mois de mai.
Une heure avant la cérémonie, le beau-frère nous avait distribué les alliances à chacune, d'identiques anneaux de platine sertis de diamants. Les hommes, eux, n'en portaient pas. Comme je m'en étonnai, on me cloua le bec d'un seul mot: la coutume. La vérité n'était que pratique, donc logique, partant, irréfutable: imaginerait-on le possesseur de quatre femmes légales bagué à tous les doigts?
Il existe toujours une vérité pas compliquée. Elle est à portée de la main, du reste, cette vérité, mais silencieuse comme un cancer, on la découvre quand ça fait mal.
Le maazoun officie, ses robes proprement étalées sur le canapé Louis XV, sa barbe étalée de même, en bavoir satisfait. Nos deux couples se font face. Les hommes posent la main sur le Coran. Des palabres en arabe, des Arabes en palabres. Personne ne s'intéresse aux épouses, aux femmes on ne demande rien. Le mariage: une affaire d'hommes.
L'Allemande a échangé son air ahuri pour une expression d'intense satisfaction, elle qui n'était venue à Beyrouth que pour faire la saison. Et moi? Que lit-on à ce moment-là sur mon visage béta de gamine à la queue de cheval? Le malaise, l'épouvantable sensation que cela devrait être autrement. Et je cherche refuge auprès de tes yeux, qu'ils me rassurent, me disent que nous faisons tout cela pour sauver nos nuits, pour que nos chairs amoureuses, d'un même grain, d'une même espèce désormais, ne frémissent plus à l'idée de leur séparation. On ne nous amputera pas l'un de l'autre. Mais tu ne me vois pas, tu ne me dis rien. Déjà je ne te reconnais pas, tu parles une autre langue, tu es si loin dans le pays des hommes, avec eux tu ris d'un rire gras.
On m'a séparée de toi.
Aéroport international de Beyrouth, dans une heure nous embarquerons pour Dubaï. Sur la mer Rouge? L'océan Indien? Est-ce en Asie ou en Afrique? Je n'en sais superbement rien. Qui en Europe connaît cet émirat confetti? Je sais seulement que c'est là qu'on nous envoie, qu'on nous recevra, nous mariera à nouveau, et nous remariera autant de fois qu'il le faudra et même jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le mariage libanais vient d'être refusé par l'ambassade: les Qatanis n'ont pas le droit d'épouser des étrangères.
Et nous voilà au comptoir d'embarquement où le beau-frère fait valoir son charme de nain moustachu, ses relations, son fric, gesticule en vain devant l'hôtesse, s'étouffe en une crise d'asthme et de fureur. On me refuse l'accès à bord. Pas de visa. Les émirats ne délivrent pas de visa touriste. Ces pays, ça ne se visite pas. Il faut avoir été suffisamment damné pour être envoyé là-bas. La géhenne, on ne l'a jamais volée, ça se mérite. L'enfer ne veut pas de moi.
Tu t'en vas, et tu nous quittes, Tu nous quittes et tu t'en vas.
Je reste idiote, "malhûreuse" comme dans ces complaintes de Laforgue qui sautillent dans ma mêmoire, petits moineaux aux pattes maigres. De la terrasse de l'aéroport on a vu décoller l'avion. J'étais dans le tremblement des moteurs, dans la vibration épaisse de l'air autour de l'appareil. Middle East Airlines, l'avion au cèdre, vite mangé par le bleu du ciel, tour de magie... escamoté.
Ma première tristesse d'aéroport.
Il y en aura bien d'autres, toujours les mêmes, mais plus d'aéroport international de Beyrouth. La terrasse s'effondrera, les façades béeront en d'immondes grimaces sous les tirs des lance-roquettes, des monticules de gravats, des cratères échevelés de ferraille à tous les étages, les vitres seront soufflées, les comptoirs pillés, les fauteuils des salles d'embarquement arrachés, embarqués! Je traverse l'Apocalypse à venir qui ne se doute de rien, flots d'estivants, bagages de luxe, longs cheveux plats des pin up, des senteurs de Guerlain et de rouge à lèvres.
Ils sont tous morts, tous en sursis, personne ne se doute, sauf moi, pour qui le jour s'est obscurci en plein midi. Je traverse, effarée, les diverses salles de la flambante entreprise de pompes funèbres, funeral parlor à l'américaine, la douceur morbide de ses carrelages, les panneaux noirs, Arrivals, Departures, électroniques épitaphes, regrets éternels. Comme les bêtes, je sens la mort.
On me dit que pas plus tard que demain je te rejoindrai. On obtiendra ce maudit visa, sûr et certain. Le beau-frère me le jure, il appellera le cheikh de Dubaï en personne pour qu'il donne ses ordres au consulat. C'est un ami, le beau-frère connaît toutes les barbiches couronnées de la région. Du diable s'il ne me met dès demain dans l'avion.
Je me laisse véhiculer dans la Jaguar, on me ramène seule, moitié de siamoise qu'on vient de sectionner. Douleur insoutenable, anesthésiante. On m'a arrachée à ta langue! Je reste là, ahurie, dans quel pays?
"Qu'il revienne... qu'il revienne à lui! Taïaut! taïaut! et hallali!" Ma tête résonne en plein été des gongs hivernaux, des tempêtes laforguiennes. "Et il gît là, comme une glande arrachée dans un cou. Et il frissonne, sans personne!..."
Je suis recroquevillée à l'arrière, le beau-frère raconte certainement quelque chose, je vois ses mains qui font la pavane sur le volant, minuscules et manucurées, des mains de poupée. Greta à tout bout de champ vient frotter contre le cher petit mari sa tête rousse, gonflée monstrueusement par la mise en plis, en émettant des paroles à la tendresse gutturale, de l'anglais germanisé.
Drink SEVEN UP. Drive Toyota. Firestone. An apple a day keeps the doctor away. Les affiches gigantesques, elles aussi, jacassent sur ma droite le long de la route, doublées de lettres arabes lascives qui dansent dessous, langage pour moi aussi silencieux que la gestuelle des sourds-muets. Les immeubles poussent, poussent à même le sable. Des vitres, des vitres et des balcons. Que l'air et le soleil entrent à grands flots et le bruit de la mer, partout! C'est le pays d'Astarté Tanit au ventre fertile. Les pelleteuses piochent du nez dans une terre chaude et rouge, que l'on malaxe, que l'on arrose et qui fleurit aux terrasses tandis que les grues infatigables rajoutent encore des étages. Le président Camille Chamoun est un vieux Chinois bien élevé. Miss Liban a été sacrée Miss Univers. Brave petite Giorgina! Aux Caves-du-Roy on élira Monsieur Moustache. Apostrophe est retransmis en direct le vendredi. Toutes les curiosités touristiques, toutes les activités sportives: à une heure de route prenez un bain de mer et skiez sur les pentes du mont Liban. Cloches et muezzins. Les amis de la France et du Christ prénomment leurs filles Jeanne d'Arc. Liban en arabe signifie "lait". C'est la terre nourricière où coule le lait, pas le sang, jamais.
A chaque minute j'ai l'impression que ça y est, un de ces taxis fous qui foncent, semblent prendre leur élan avant d'avaler la montagne, va nous heurter de plein fouet. Pulvérisée! La fin de l'aventure. Je m'obstine à ma fatalité, je l'appelle, comme on agace de la langue le trou d'une carie.
Les pinèdes et leurs frondaisons obscures, charbonnées dans les lointains. Des bidonvilles. Au feu rouge des gamins nous assaillent, le beau-frère distribue quelques lires. L'Allemande proteste : "Zoze Palestinians, zey should worrrk." Deux camps à l'entrée de la ville, deux testicules bruns où grouillent des milliers de germes qui mourront, Sabra et Chatila.