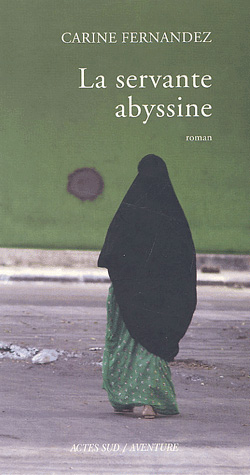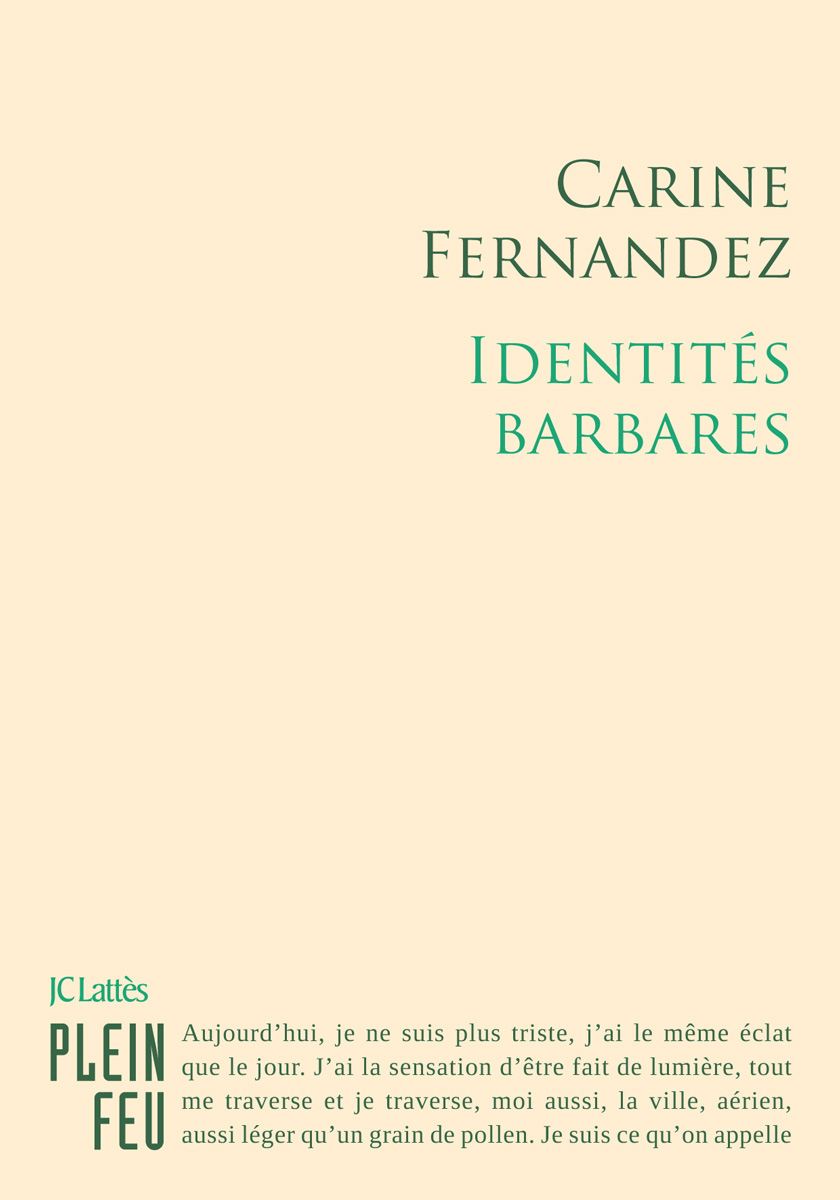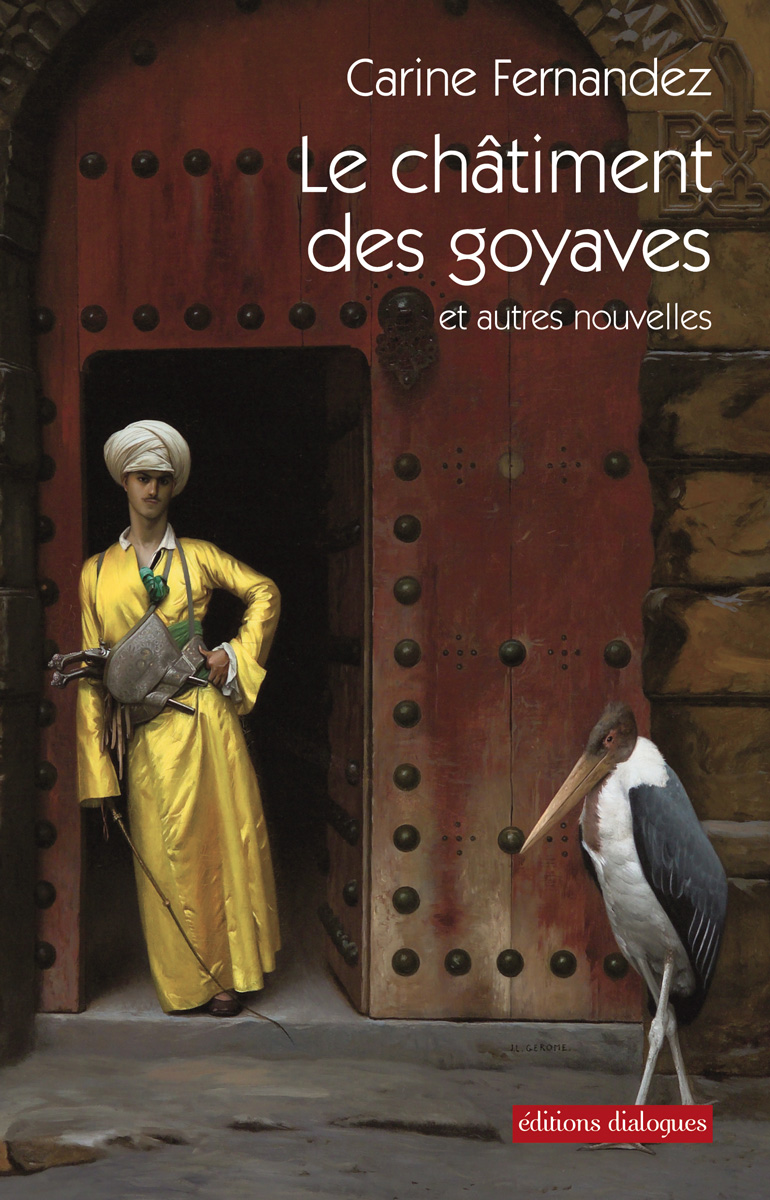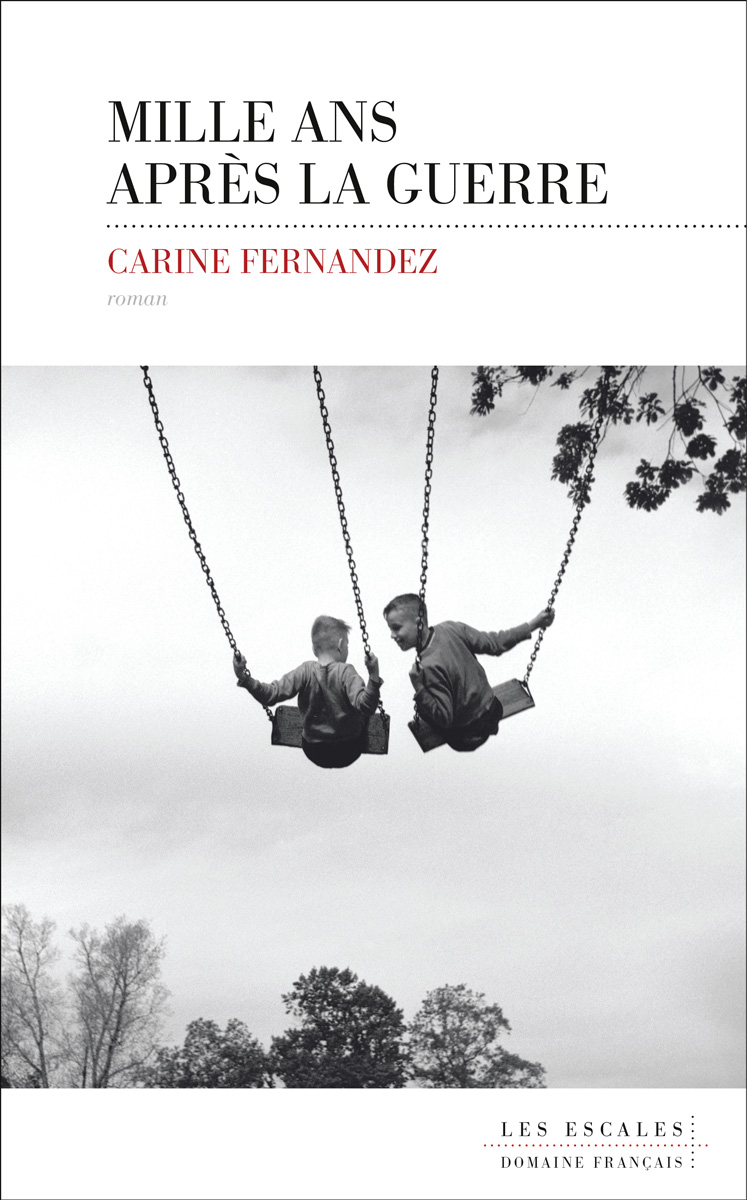Dans le lazaret lyonnais
Les écrivains en confinement
Entrée principale du lazaret de Port Mahon (îles Baléares)
Lazareto Island, Port of Maó, Menorca © MontanNito
Après une première vie aventureuse et honteusement romanesque (elle s’enfuit à seize ans en Orient d’où elle ne reviendra que 20 ans plus tard), elle s’est sédentarisée dans la région lyonnaise. Elle a publié 7 livres, chez Actes Sud, J.C. Lattès, Les Escales ; toujours le nomadisme, éditorial cette fois. Mille ans après la guerre (Les Escales 2017), couronné notamment par le Prix Henri de Régnier de l’Académie française et le prix Lettres Frontière, a été traduit en espagnol. Son dernier roman Un jardin au désert (Les Escales 2019) est une fresque familiale échevelée dans l’Arabie contemporaine. Également poète elle a publié en 2019 Les routes prémonitoires aux éditions La Passe du vent. Carine Fernandez est titulaire d’un doctorat d’état de littérature du XVIIIème sur Vathek de Beckford, ce qui est la manière la plus monomaniaque de perdre son temps. Elle a l’âge qu’elle a.
« Ça alors ! Tout le monde s’est mis à vivre comme moi ! Les humains ont regagné leur tanière, sommés d’hiberner au temps des cerisiers en fleurs. Le confinement planétaire me laisse totalement ébaubie. Moi qu’on taxait d’anormale, d’asociale, de solitaire, de misanthrope, d’ermite et plus affectueusement d’oursonne. Moi qu’on enjoignait de changer, de m’adapter au rythme du monde, voilà que le monde entier s’est adapté au mien ! Le Covid 19 fait vivre la planète au rythme des écrivains … et des phobiques sociaux !
« Confinement », encore un euphémisme, un de ces lâches éléments de langage pour ne pas dire ce que les Espagnols appellent franchement l’enfermement : « el encierro ». Je l’appellerai quarantaine, en espérant qu’elle n’excédera pas ce chiffre. Pas tellement pour moi, pour qui ça ne change pas grand-chose. Mais pour les autres, ceux que j’aime – et même ceux que je n’aime pas – et aussi pour tous ceux que je ne connais pas et qui se sont mis à me ressembler. Mes frères humains, si lointains, si proches tout à coup. Et nous voilà conscients de faire partie d’une même espèce, susceptible de choper le sale virus, et qu’on enferme. Tandis que les bêtes sont plus merveilleusement libres qu’elles ne l’ont jamais été. Nous savons maintenant que nous ne sommes pas des bêtes, le Covid19 a reconnu les siens.
L’enfermement, le « rester chez soi », je dois dire que j’ai un entraînement olympique pour la discipline. La bibliothèque a toujours été ma première patrie, le canapé la seconde. Je suis binationale. Et pour avoir vécu des années en Arabie Saoudite où la clôture n’était pas un vain mot, j’ai plus de résistance au confinement qu’un cosmonaute de la NASA. Le port du masque et la distanciation sociale aussi, je connais. Mais ces mesures de précaution étaient là-bas réservées aux femmes.
Avril 2020 – Je suis seule dans mon appartement à l’Ouest de Lyon ; j’ai toujours été à l’ouest. Le soleil est mon ami et l’écureuil qui grimpe cinq étages pour venir me saluer sur mon balcon. L’écureuil est mon ami, mais pas l’ascenseur ! L’ascenseur est un monstre couvert de boutons sournoisement infectés. Et l’escalier en colimaçon où l’on risque de buter sur d’autres pesteux confinés n’est pas mon ami non plus. J’aimerais avoir des ailes comme les corneilles qui font des loopings dans un ciel bleu sans avion (tiens, ça pourrait faire un chouette nom de couleur : le « bleu sans avion »).
A part ça, la vie en quarantaine ne change rien pour moi. Si ce n’était mon inquiétude pour mes proches, désormais si loin, je serais plus heureuse que Saint Antoine au désert. Lui devait résister, le pauvre vieux, seul avec son cochon, à toutes les tentations du diable. Mais le diable n’est plus polymorphe, il ne se cache plus sous les courbes affriolantes des succubes, le démon a pris la forme d’une boule microscopique hérissée de picots qui vous saute au visage.
A l’époque des saints et du démon, il y avait le Monde, antinomique de l’ermitage. Le monde et ses tentations, versus la clôture. Eh bien ! C’est terminé ! Depuis la quarantaine, le monde n’existe plus. On nous a privés de l’extérieur. Plus le droit de voyager, visiter, randonner, musarder. Mais qui aurait encore envie de voyager dans des contrées vides d’humains, atrocement ? Le monde nous est interdit, dès lors il n’existe plus pour nous. Peut-être pas si fou, l’ami Berkeley qui niait l’existence du réel. Si on ne le voit pas, c’est que le réel n’est pas, disait l’allumé philosophe. Ça s’appelle l’immatérialisme. Une doctrine à laquelle on va tous finir par se convertir.
Que fabrique donc la nature depuis que l’homme lui a foutu la paix ? Une grande première depuis des millénaires. Et je me demande si, en l’absence d’humains, les montagnes et les forêts, les rivages et les océans, les fleuves et les prairies n’ont pas tout simplement cessé d’exister.
Le monde vrai, celui que nous habitons, s’est singulièrement rétréci aux limites de l’appartement, et lorsque par extraordinaire, nous sortons, nous marchons dans un cercle invisible qu’on appelle distance de protection. Les caissières nous craignent autant que nous les redoutons. Notre mort, la nôtre que nous ne nous connaissons pas, aura peut-être le regard las de cette femme qu’on envoie sur le front en première ligne.
Alors on ne s’attarde pas dehors. On rentre chez soi en loucedé et on désinfecte ses courses comme si on sortait de Tchernobyl. Et on cuisine.
Pas moi ! Je ne fais pas de soupe, je ne mitonne pas et j’ai longtemps appelé Picard : bienfaiteur de l’humanité. Je ne veux pas engorger davantage les hôpitaux en courant le risque de faire des cookies (souvenir d’une ou deux galettes plus cramées que Saint Laurent sur son grill.)
Non, je ne sais rien faire de mes dix doigts, hormis tourner des pages et taper sur un clavier. Deux activités qui ne nécessitent pas de planning pour « structurer » ses journées. Je vis et j’écris à l’instinct, en suivant ma pente, de manière quasiment animale (si les bêtes écrivaient…). Les bêtes n’ont pas besoin de planning pour savoir quand chasser, manger, baiser, dormir.
La bibliothèque est là. Mon terrain de chasse. Je lis dix livres en même temps. Je prends, je jette, je les flaire comme le chat que je n’ai pas. Trois coups de stylet de Cioran, deux chapitres de Stendhal. Après la rage jouissive de Thomas Bernhard, j’ouvre Robert Walser et d’un coup le jour redevient féérique et l’homme bon. Mais Walser était fou n’est-ce pas ? La littérature est une maladie mentale.
On se croirait revenu au 18ème siècle où s’opposaient les théories sur la propagation de la peste. Par contact ou par aérosols ? On en est là ! Humanité désormais masquée. Nous voilà condamnés à croiser des fantômes, sans visages. Cette rencontre des visages qui était pour Lévinas le signe de reconnaissance de l’humanité de l’autre. Bientôt le masque obligatoire. Seuls les yeux où se réfugie la peur.
Non, décidément, le monde réel n’est pas sérieux ! Seule la fiction est encore crédible.
Alors, pour survivre, il ne nous reste plus que l’écriture, comme Flaubert, confiné volontaire à Croisset, il nous faut « niaiser et fantastiquer ».
Finalement nous vivons une quarantaine inversée. Autrefois le lazaret était ce lieu d’enfermement où l’on mettait les voyageurs en quarantaine afin de préserver le reste du pays, aujourd’hui chaque foyer est devenu lazaret. Home sweet lazaretto !
Par une ironie du sort que les Anglais appellent joliment poetic justice, le roman auquel je travaille depuis un an est un récit picaresque qui se déroule en 1800 à Minorque, dans … le lazaret de Mahon ! J’espère que j’en viendrai à bout. Je n’ai jamais écrit aussi lentement, les montres et les horloges sont devenues plus molles que celles de Dali, marquant les heures distendues d’une autre temporalité : le temps du Coronavirus. Je suis comme nous tous, « hors de moi », la cervelle évaporée depuis le début de ce coup d’état sanitaire mondial. Et j’avoue que voir ma fiction rattrapée par le réel m’a passablement plombé le moral. Roman maudit dont le titre me chante dans la tête depuis longtemps : L’amour au lazaret.
Quand je présentai le projet, on me le déconseilla. « Tu sais, la peste, de nos jours ça n’intéresse plus grand monde. Tu devrais écrire quelque chose de plus actuel ».
Plus actuel ? »
Texte donné à la médiathèque de Chambéry pour «Les flashbacks du patrimoine» Automne 2017.
Carine Fernandez retranscrit ici le très ambitieux projet du militaire et historien François de Regnauld, marquis de Lannoy de Bissy (1878-1935), auteur de la première carte générale détaillée du continent africain. Elle nous raconte, aussi, la rencontre entre l'explorateur Jules Borelli et le négociant français Arthur Rimbaud. Devenus compagnons de voyage, ils parcourent ensembles le Harar (actuelle Éthiopie) et tracent les cartes qui serviront au gigantesque projet de Lannoy de Bissy quelques années plus tard.
LA ROUTE DE HARAR
Mon colonel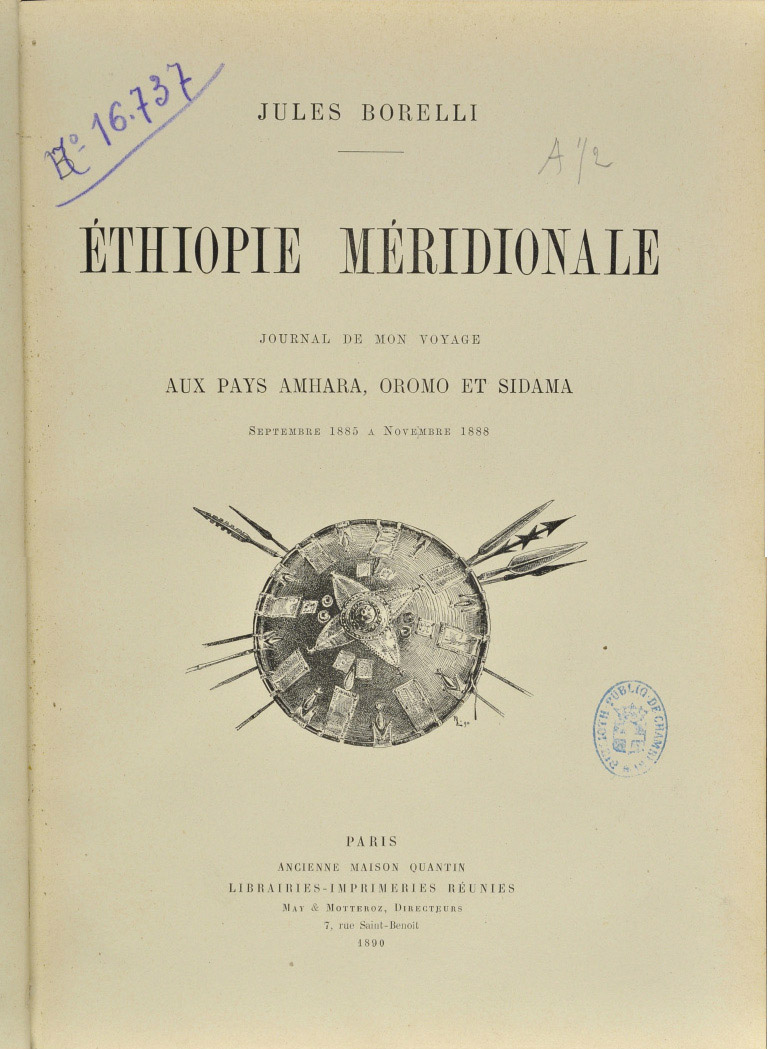 J’ai peu d’usage des militaires et encore moins des capitaines du génie que j’ai le préjugé de croire plus capitaines que génies. Pourtant, me voilà invitée dans la forteresse du capitaine, devenu colonel et grand maître de la légion d’honneur. Quelques jours dans l’intimité de Richard de Regnault de Lannoy de Bissy (1844 -1906). Je ne fréquente que des militaires morts. Le personnage repose au plus profond de la bibliothèque de Chambéry, dans les travées du fonds ancien, avec son bicorne à plumes, ses moustaches relevées en croc de sanglier et son armée de papier : le fonds «Lannoy de Bissy», légué à la ville par son fils. Il faut dire que le colonel mania davantage le crayon que le sabre, ce qui le rend illico plus avenant. Voilà qu’un soir de 1874 , alors qu’il quittait l’Algérie après six ans à tracer des routes et cadastrer le désert, debout sur le pont du navire, regardant s’éloigner les falots du port, - rien n’empêche d’imaginer notre capitaine posant en héros romantique - lui vint cette idée prodigieuse: établir la première carte complète d’Afrique. Une idée épatante vraiment, sans laquelle nous ne nous serions jamais rencontrés. J’ai un faible pour les géographes.
J’ai peu d’usage des militaires et encore moins des capitaines du génie que j’ai le préjugé de croire plus capitaines que génies. Pourtant, me voilà invitée dans la forteresse du capitaine, devenu colonel et grand maître de la légion d’honneur. Quelques jours dans l’intimité de Richard de Regnault de Lannoy de Bissy (1844 -1906). Je ne fréquente que des militaires morts. Le personnage repose au plus profond de la bibliothèque de Chambéry, dans les travées du fonds ancien, avec son bicorne à plumes, ses moustaches relevées en croc de sanglier et son armée de papier : le fonds «Lannoy de Bissy», légué à la ville par son fils. Il faut dire que le colonel mania davantage le crayon que le sabre, ce qui le rend illico plus avenant. Voilà qu’un soir de 1874 , alors qu’il quittait l’Algérie après six ans à tracer des routes et cadastrer le désert, debout sur le pont du navire, regardant s’éloigner les falots du port, - rien n’empêche d’imaginer notre capitaine posant en héros romantique - lui vint cette idée prodigieuse: établir la première carte complète d’Afrique. Une idée épatante vraiment, sans laquelle nous ne nous serions jamais rencontrés. J’ai un faible pour les géographes.
Il aura fallu ce départ et la mort de Livingstone quelques mois auparavant pour faire naître ce projet. Lannoy de Bissy fera la carte que Livingstone ne fera plus. L’explorateur anglais élevé au statut de mythe vivant, disparu trois ans dans la jungle alors qu’il cherchait les sources du Nil, avait été retrouvé au milieu d’une tribu par le journaliste Stanley. Et là, pour la plus grande joie de la postérité et des lithographes qui immortaliseront la scène, Stanley ôte son chapeau et prononce la phrase aussi fashionable qu’apocryphe: «Dr. Livingstone, I presume?». Livingstone se fend d’une courbette, mais refuse de retourner à la «civilisation», en dépit du champagne apporté par Stanley dans sa musette pour fêter les retrouvailles. Il reste pour achever son œuvre, c’est son œuvre qui l’achèvera.
Tous les itinéraires de Livingstone, Lannoy les a arpentés. Sur le papier. S’il s’incline devant le héros, chapeau bas comme Stanley, il fronce le nez devant le géographe. Ses cartes de détail sont bien trop sommaires! Quant à la carte d’ensemble, elle est ridiculement réduite, impraticable ! Lannoy serait plutôt un anti-Livingstone. Il ne plongera pas dans les tréfonds du continent noir, au contact de la terre et des populations comme l’explorateur missionnaire, non, c’est des profondeurs douillettes de sa chauffeuse capitonnée, bien à l’abri en France, qu’il dessine son Afrique, une Afrique mentale.
25 ans plus tard, il a la carte, un atlas en 63 feuilles à l’échelle 1/ 2 000 000, la carte et la légion d’honneur! Il a gagné son pari! Une entreprise folle, jamais tentée auparavant. Le grand corps de l’Afrique, mis à plat sur la table du cartographe. Tout répertorier, cataloguer, s’approprier dans une fringale insatiable. Lannoy annexe ses territoires de papier, patiemment, zone après zone. Un Alexandre des écritoires. Le soldat géographe est mis en disponibilité pour se consacrer uniquement à sa carte, à temps complet, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, deux tours au cadran de sa montre à gousset, qu’il ne retire même pas pour la poser sur la table de nuit. Quand est-ce qu’il dormirait? Il lui faut diriger ses troupes de géographes, voyageurs, militaires, disséminés aux quatre coins de l’Afrique avec lesquels il échange des centaines de lettres. Maître d’œuvre du projet, rien n’échappe à son lorgnon à monture dorée. Pas un chemin tracé dans la brousse qu’il n’en soit informé. Lannoy a ses hommes sur le terrain, ses cartographes et ses savants dans les sociétés de géographie, il est seul au centre de ce réseau international, à collecter ses données, un siècle avant internet, tel Dieu au centre de sa création. Seul à inventer un continent. A défaut d’arpenter le territoire, comme Livingstone, Lannoy arpentera la carte.
L’encartement du monde
La carte et le territoire , belle formule, empruntée à Houellebecq - aux titres souvent meilleurs que le contenu, - qui l’ avait lui-même empruntée sans vergogne à un obscur romancier, lequel reprenait l’expression de Korzybski,: «la carte n’est pas le territoire». Sans doute, mais prise de possession mentale du territoire. L’origine de la carte est politique, elle a partie liée avec le pouvoir, partant avec l’armée. La première carte de France n’est – elle pas la carte d’état-major?
Une carte et voilà la terre surplombée, cadastrée, dominée. La carte, divine abstraction afin de prendre de la hauteur, éviter d’être englué dans la complexité du réel. Contre le regard myope, il faut le surplomb. La carte: l’œil de Dieu. J’aime à penser que la carte est née avec le langage. La même nécessité de représentation abstraite du monde. Le mot n’est pas la chose, la carte n’est pas le territoire, mais elle en livre l’accès. Toutes les cartes mènent à l’île au trésor, comme celle de Long John Silver, l’affreux pirate de Stevenson. «The villain», à prononcer avec l’accent anglais. Le méchant, si nécessaire dans la cartographie mentale de l’enfance, traversée par la ligne verticale qui sépare le Bien et le Mal, tel le Méridien divisant l’Amérique entre Espagnols et Portugais sur les cartes blasonnées du traité de Tordesillas. On peut imaginer que nos ancêtres du paléolithique avaient déjà leurs mystérieux tracés sur les parois des cavernes pour indiquer où le gibier, où la cueillette, où le danger. Cartographes, les Néanderthaliens! cartographes, les Sumériens, qui gravent sur l’argile des tablettes les premières représentations du monde, avant Erastothène, avant Ptolémée l’inventeur de la planisphère, avant Anaximandre, le plus visionnaire, avec sa carte toute ronde, comme un œil, comme une matrice, cerclée par le noir océan.
Le lent travail du dessinateur cartographe, un métier qui a disparu comme celui de meunier, de bourrelier, de sabotier, de stoppeuse de bas, de crieur public, de porteur de chaises à porteur, noyé dans le tsunami des avancées technologiques. Même si quelques-uns reviennent qu’on croyait morts, comme les cireurs de chaussures, encore prisés à l’Elysée.
Pas les cartographes. Morts et bien morts, plus raides que leurs cartons. Le monde vu d’en bas, arpenté par les explorateurs, bascule en monde vu d’en haut, balayé inlassablement par l’œil des satellites. Avec Google Earth le territoire disparaît pour devenir carte. Le monde n’a plus à être représenté , c’est-à-dire symboliquement dupliqué. Vu du ciel, il est là, en direct, il est là, à notre portée, virtuel. Le réel est devenu cette abstraction sur écran plat, disponible en deux clics. Monde carte, monde à la carte.
Les cercles de l’Enfer
Ce matin, descente au fonds ancien de la bibliothèque de Chambéry, escortée par mon aimable bibliothécaire, la maîtresse des secrets. Tandis qu’elle déverrouille devant moi une enfilade de portes, aussi blindées que la chambre forte d’une banque hélvétique, je m’imagine Dante sur les pas de Virgile, franchissant les cercles de l’ Enfer.
J’ai longtemps fréquenté les bibliothèques patrimoniales. Comme d’autres se démènent sur les pistes de ski ou les chemins de randonnée, le seul sport que je pratique avec constance est le biblio-surfing. J’ai prêté serment à La Bodléienne d’Oxford, après m’être délestée de tout ce que je portais, jusqu’au dernier stylo. Non, je ne vandaliserai pas, ne souillerai pas, ne volerai pas, les précieux ouvrages, non je n’arracherai pas des feuillets pour les cacher dans ma culotte, non je ne bouterai pas le feu à la bibliothèque. Je le jure! Une cérémonie initiatique intimidante avant l’émotion qui me submerge brutalement devant les manuscrits de William Beckford. Lettres vibrantes, écrites il y a deux siècles par un jeune homme de vingt ans. J’ai attrapé des lumbagos dans l’antique BNF, courbée sous le halo des lampes, dans la cyclopéenne salle Labrouste, à côté de vieux messieurs monomaniaques. Des années dans les bibliothèques, sans en percer le mystère. Je ne les connaissais qu’en surface, comme une invitée qu’on accueille au salon. Je n’en avais jamais sondé le silo, la réserve, l’office.
Mais maintenant j’y suis. Dans les archives. Comme Nerval, j’ai la sensation d’avoir franchi les portes de corne et d’ivoire. Me voilà parvenue au royaume des morts, au sein d’une nécropole peuplée d’âmes, tellement vivantes, de morts anciens. Je les entends doucement bruire sur les étagères, dans leurs cercueils reliés en plein maroquin. Ils restent là, debout sur la tranche, serrés les uns contre les autres, dans l’indifférence des siècles, classés non par ordre alphabétique, mais par taille. Les plus grands dominant les minus du haut de leur in-folio. Comme toujours. De loin en loin, un appelé sort du rayon, remonte à la lumière, pour être enfin tenu dans des mains tièdes, amoureuses. A la place, laissée vide, le bibliothécaire glissera une «fiche-fantôme», la bien nommée, pour remplacer l’absent, le revenant, repassé quelques heures du côté des vivants.
Les bibliothécaires sont nos fonctionnaires poétiques de l’imaginaire, un pied dans le réel, l’autre dans la bouche d’ombre qui appellent leurs fiches « fantômes ». Je pense à Nodier, bibliothécaire à l’Arsenal, à Borges, à Buenos Aires, à Umberto Eco dans la bibliothèque médiévale de l’Université de Bologne , je pense à Smarra, au Livre de sable, à la bibliothèque de Babel, au Nom de la rose. Le fantastique a partie liée avec la bibliothèque.
Emboîtements d’échelles
Toute l’Afrique est là, en Savoie. Une somme prodigieuse de cartes, de lettres, de récits de voyages. Launay de Bissy a tout conservé. Articles de presse où l’on peut suivre au jour le jour les expéditions des puissances européennes. Leurs rivalités. Riches heures du colonialisme conquérant. La petite Belgique en passe d’annexer le gigantesque Congo. La couleuvre a avalé l’éléphant. «Le mouvement géographique de Bruxelles» donne des nouvelles des voyageurs, les «Nouvelles du Congo» sonnent le clairon. Triomphalisme et «story telling» avant la lettre. La colonisation comme récit d’aventures. Des titres d’articles pour embarquer le lecteur jusqu’à la dernière ligne – habilement suspendue - du feuilleton. La suite au prochain numéro. «Aventures du capitaine Hanssens», «On avance sur toute la ligne», «Au pays des Bangalas», «Toujours devant!»
Il faut imaginer ces bourgeois ventrus de la IIIème république, ces assis à rouflaquettes, courir les déserts, tailler leur chemin dans la brousse, sans cesser de faire «corps avec leurs chaises». Par la seule magie du récit de voyage. Le récit de voyage comme aventure par procuration. Mieux! Comme rédemption! Chaque voyageur est un héros et un prophète. Le voyageur est le voyant, à une voyelle près. Il est celui qui a vu et qui donne à voir. L’étonnant voyageur de Baudelaire.
En la matière, Lannoy a percolé toute la bibliothèque. Pas un récit de voyage ne lui a échappé. Je lui fais confiance, maintenant qu’on se connait. Un territoire seul me retient, d’une manière instinctive, l’Abyssinie où je n’ai jamais mis les pieds mais qui m’inspira mon premier roman, La servante abyssine. Je ne la connaissais que de loin, de Djeddah où je vivais à l’époque. J’en respirais l’haleine, les jours où le khamsin couvrait tout d’une poussière rougeâtre, venue des côtes d’Afrique. Je la devinais. Parfois je lui donnais une silhouette, les corps élancés des travailleurs Erythréens sur le chantier; un visage d’or brun, celui d’une servante délurée au regard étincelant. Mais maintenant j’y vais, je saute le pas, c’est-à-dire la Mer Rouge. Je vais suivre Lannoy dans ses explorations. A sa façon peinarde, sans prendre de risques, sur des sentiers de papier.
Un ascenseur me ramène du côté des vivants dans la salle de travail, avec ma moisson de documents et quelques ectoplasmes passés en contrebande. Un plein chariot de cartes, de récits de voyage, des cahiers manuscrits. Compilations des lectures de Lannoy, entre la fiche et le reader-digest. Wikipédia avant la lettre. Je m’émerveille une fois de plus des capacités de travail – de masochisme - du Colonel, forçat de la cartographie.
Deux cavaliers dans le Choa
Dans les hampes de l’écriture aristocratique de Lannoy, je tombe sur le résumé du voyage de Borelli: «Ethiopie méridionale, journal de mon voyage au pays Amhara, Oromo et Sidama (septembre 1885 à Novembre 1888)». Une connaissance! Jules Borelli, l’explorateur, le compagnon de voyage de Rimbaud à travers le Harrar. Lannoy note l’arrivée à Toudjourah le 9 février de M. Rimbaud, négociant français. Sans plus. Sans se douter, comme tous ceux qui le rencontrèrent en Orient, comme Borelli lui-même, qui passa des mois avec Rimbaud, à partager le même bivouac, les mêmes fatigues, les mêmes dangers, sans s’imaginer un instant qu’il côtoyait le génie précoce de la littérature. Dans cet épicier qui trafique des fusils, personne n’a vu le «passant considérable» de Mallarmé. Epoque où Rimbaud n’est pas Rimbaud, seulement un négociant français, expérimenté, consciencieux, apprécié par ses employeurs, mais tenu à distance par les Européens qui le trouvent bizarre, se méfient de ses sarcasmes. Voyons voir, que dit Borelli de cette rencontre du 9 février 1887? «Notre compatriote a habité le Harrar. Il sait l’arabe et parle l’amhariga et l’oromo. Il est infatigable. Son aptitude pour les langues, une grande force de volonté et une patience à toute épreuve le classent parmi les voyageurs accomplis.»
Ce que Borelli ne dit pas, c’est que sans Rimbaud il n’aurait pas pu effectuer ce voyage. Son entreprise scientifique n’était pas prise au sérieux, le roi Ménélik ne lui aurait jamais donné l’autorisation de le faire seul. Rimbaud devait acheminer des armes à Ménélik, la caution était suffisante. Et les voilà partis de concert, les deux cavaliers dans le Choa, le marchand d’armes et le géographe. Au fond, Borelli est le scientifique, l’explorateur que Rimbaud aurait voulu être, mais il est condamné à son désespérant négoce. L’argent, les thalers Marie Louise, qu’il faut convertir en or et planquer dans cette ceinture qui lui scie les lombaires!
Il n’est pas le fils de Vitalie Cuif pour rien. Ses lettres à sa famille ressemblent à des carnets de dépense, ponctués de de lamentations. «Les années passent et je n’amasse rien, je n’arriverai jamais à vivre de mes rentes dans ces pays».
Ce voyage aura ravivé des velléités scientifiques chez Rimbaud. L’été suivant, de passage au Caire, il enverra au «Bosphore égyptien», journal francophone, dirigé par le frère de Borelli, un long article sous forme de lettre pour rapporter ce voyage. Ni poésie, ni exotisme, des descriptions pratiques, du factuel et surtout une étude sur l’intérêt économique du Choa et les possibilités d’une ligne de chemin de fer. Seulement, ici et là, quelques sonorités noires, l’adjectif «horrible» qui revient, lancinant: «routes horribles», «cloaque horrible». On ne sort pas de la Saison en Enfer.
Borelli, plume de Rimbaud! Il écrit et publie en 1891 le livre que Rimbaud n’écrira pas, ce monumental journal de voyage illustré de dessins au fusain. Au départ, une multitude de photos, prises sur le vif. Portraits de femmes Danakils aux coiffures pharaoniques, de guerriers au regard inquiet, villages étagés aux toits de chaume, semblables à des chalets, dans la verdure de la «Suisse africaine». Borellli fait dans le pittoresque, des chromos pour Européens en mal d’exotisme. Je ne peux m’empêcher de penser qu’il donne à voir ce que Rimbaud a vu. Les photos qu’il a prises sont celles que Rimbaud aurait pu prendre. N’avait-il pas commandé à sa mère un coûteux appareil photographique? «Si je veux, je regagnerai vite les 2000 francs qu’il m’a coûté. Tout le monde veut se faire photographier ici» Une nouvelle carrière de photographe colonial! «La science, la nouvelle noblesse! Le progrès» Peut-être y croit-il sous le sarcasme. Les illuminations naîtront de la chambre noire, il faut «être résolument moderne». Etranges photos! Instantanés de la douleur, immortalité de l’ennui. Cet autoportrait, un visage dur de bagnard, les bras croisés sous le bananier, en camisole et pantalon blanc. «Le forçat intraitable sur lequel se referme toujours le bagne». Le bagne se referme sur sa carrière de photographe. Son projet d’expédition photographique au Choa sombre dans la faillite de son patron, Bardey. L’appareil photo est vendu, le livre sur Le Choa, destiné à la société de géographie de Paris ne se fera pas. Ou plutôt, c’est Borelli qui le fera. Et le voilà, escortant ce géographe marseillais qui lui vole les images qui étaient les siennes, qui dessine sa carte.
CARTES SANGLANTES
Cartes sur tables. Elles sont là devant moi, sur la table de la bibliothèque, ces cartes de Borelli sur papier calque de couleur bronze, papier pelure, translucide comme une peau humaine. L’itinéraire tracé à l’encre rouge, de Tadjourah à Antototo et retour par Zeyla, chemin de sang sur une peau brune. Scarifications rituelles. Le fil rouge incise le territoire. Au nord, le pays Afar des Danakils, au sud, le pays Somali des Issas, les peuples ennemis. Entre les deux, le chemin, jalonné de petits ronds, des villages, méticuleusement nommés. Comme le Yavhé de la Genèse, le cartographe nomme le lieu, afin que le territoire soit. L’appropriation par la toponymie. Et la terre parle. Elle se livre, elle murmure ses noms aux sonorités rauques: Zargé, Tchorra, Arawa, Harrar, Walisso, le volcan Zoukouala et la rivière Aouache. Multitude de noms vrombissant comme des mouches sur la carte. Ils ne seraient pas à faire tout ce ramdam, si Rimbaud ne les avait pas d’abord prononcés, en prenant soin de bien articuler, afin que Borelli les écrive. Chaque soir, au bivouac, le cartographe prend des notes, transcrit les toponymes sous la dictée de ce blanc taciturne qui parle plusieurs langues d’Ethiopie, après avoir renoncé à inventer la sienne. Lui qui, à l’époque de la lettre du voyant, s’acharnait à «Trouver une langue», voilà qu’il en trouve plusieurs. Langues «nègres», poétiques parce qu’étrangères, encore lestées d’inconnu. Arabe, Ahmariga, Orhomo, Il les apprendra patiemment, avec tout son sérieux d’ancien premier prix de version latine.
Cette carte, Rimbaud en est le co-auteur, il l’a faite, comme il a fait la route, l’aller et le retour entre Harar et la côte. Des dizaines de fois. Mais la dernière! Oh! la dernière! Juin 1891, quinze jours de voyage porté par treize hommes, sur une civière dessinée par ses soins, avec une toile en forme de dais pour le protéger du soleil. Prince de misère, la jambe raide et le genou comme une calebasse, du sang séché aux cailloux du chemin. Cette carte, il la voit encore de son lit de mort à Marseille, il suit la route sanglante une dernière fois et il refait le chemin inverse: Toudjoura, Ankober, Harar, 1976 mètres d’altitude, noté à l’encre rouge par Borelli. Il suit sa carte mentale, Il y retourne. Il rêve de repartir. La veille de sa mort, dans son délire ultime, il écrit au directeur des Messageries maritimes: «Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord?». 10 novembre 1891: pas de suite au prochain numéro.
Préface du recueil de nouvelles Passage à l’acte
en tant que présidente du concours: «Quelles nouvelles?»
Dans le monde hautement civilisé où nous vivons, où l’homme, plus nu que le premier Adam et en tous cas mille fois plus transparent, se trouve livré aux tribunaux de la Googleissime Inquisition , avec ses passions, ses goûts, ses habitudes honteuses, pour devenir cœur de cible, saignant à souhait ; dans ce monde, où chacun brandit son selfie de cadavre en sursis et photographie au resto ce qu’il va s’envoyer dans la tripe, qui aurait encore quelque chose à cacher? Ne sait-on pas déjà tout sur l’humain du siècle XXI.? tout! Voire!
Hé bien je suis heureuse de vous annoncer la bonne nouvelle, mon Evangile perso: «Ecce homo», et ce n’est pas celui qu’on croit, celui qu’on voit. Figurez-vous qu’il existe une espèce obsolète qui écrit encore. Parfaitement qui écrit et non seulement pour «communiquer» - ce qui revient à dire vite et mal l’ essentiel insignifiant - mais pour inventer, enchanter, des menteurs magnifiques, des anges de l’imposture, semblables aux « Enchanteurs » de Romain Gary.
L’homme a besoin de fiction. Et ne me dites pas que le cinéma suffit à assouvir ce besoin. Si vous jetez un coup d’œil intrigué à ce livre, ami lecteur du siècle XXI, c’est que la fiction par l’image ne vous suffit pas. L’homme a besoin de fiction ; et les plus shootés, les accros, les en manque paroxystique, se mettent à en fabriquer dans leur coin, avec les moyens du bord. On appelle ça des romanciers. On pourrait aussi bien les appeler des Diogène, ces baratineurs aux pieds sales, ces martyrs de la vérité, car rien , c’est bien connu, rien n’est plus vrai que les fables. L’homme est dans ce qu’il cache, non dans ce qu’il dévoile, dans ce qui résiste, dans sa capacité à inventer des histoires, non à dire ce qui est. La vérité de l’homme est dans ce qu’il invente. A quoi sert ce mensonge aussi vieux que l’espèce humaine qu’on appelle la fiction, si ce n’est à dire la vérité? Aragon affirmait que le roman seul permet de savoir ce qui se passe à l’intérieur d’une tête.
Non pas une, mais huit avec ce recueil de nouvelles. Huit têtes, huit nouveaux auteurs qui nous donnent, chacun à leur manière, des nouvelles des hommes. Si vous êtes comme moi, qui mets sans honte aucune mes petits petons dans les pas d’ogre de Flaubert, qui les plantait lui-même dans les sacrées empreintes de Montaigne, bref, si vous aimez vous aussi à «niaiser et fantastiquer», ami lecteur du siècle XXI, calez-vous donc un oreiller sous les cervicales et allez-y, écoutez ce que ceux-ci ont à nous dire du monde.
Un concours de nouvelles, c’est un peu un laboratoire, où tout au moins l’alambic des moines bouilleurs de cru. A la base, une sélection de plantes vivaces, au final la revigorante eau de vie. Et je dois dire que la cuvée 2014 de notre concours de nouvelles est passablement tord boyaux. Je vous préviens, pas d’histoires d’amour, la passion amoureuse reléguée au musée des éditions précédentes. Comme si le couple refuge était mis à distance. Liquidé! bazardé! Et j’avoue que j’aime ça. Le bonhomme tout seul avec ses interrogations.
Autant d’univers que de textes, ces nouvelles investissent toutes les possibilités du genre, ou presque. Du récit d’anticipation avec Dissonance, au conte philosophique ironique à la manière du XVIIIème siècle avec Le chant de l’empereur, au récit de mœurs avec Entre mecs, à l’analyse sociétale avec L’âge de feu, au encore aux zones troubles du roman noir avec Dans la brume immaculée.
Diversité d’écritures et de tonalités, mais une constante: l’ humour qui se glisse dans la plupart des textes. Qu’il soit finement maillé d’implicite dans le Chant de l’Empereur, d’un graveleux ostentatoire dans Entre mecs, ou désinvolte, comme on enlève ses bottes, dans Le triste meurtre de Jesus mouche.
Que nous disent ces textes sur le temps présent? Que plus que jamais, nous vivons dans un monde des apparences. Notre époque est baroque. La réalité est autre que ce qui nous est donné à voir. Le mort est très vivant malgré son encéphalogramme plat dans la nouvelle du même nom, la vieille dame dans l’âge de feu est restée une fillette espiègle, le récit d’anticipation de Dissonance cache l’autopsie de la folie ordinaire, et l’Empereur de Chine finira par devenir cigale. Détraqués, monomaniaques et criminels, tous les personnages de ces nouvelles passent à l’acte et réalisent leur pulsion. Pulsion de vie ou de mort, c’est tout un.
Que faire de ce chaos ? Comment donner une vision cohérente du monde? Mais le faut-il? La vie n’a de sens que dans l’acte, pas même dans l’acte, mais le passage, cette «branloire pérenne» qui a fait ricaner des générations de lycéens pour lesquels Montaigne reste un sacré branleur! Et ils n’avaient pas tort. Le roi des branleurs, Montaigne, qui a élu une vie dans les livres, hors du temps, de son temps, ravagé par les guerres de religion et la peste. Fors la peste, le nôtre n’a rien à lui envier!
Un concours de nouvelles, c’est aussi un choix, c’est-à-dire un goût. C’est pourquoi de toutes les nouvelles reçues des quatre coins de la francophonie (mot clé, aussi prestigieux que le Nobel!) nous n’avons voulu garder que les cigales, celles qui avaient la musique. Et tant pis pour les laborieuses, les muettes, les éteintes, où, le seul fracas de la chute ne parviendrait pas à réveiller le lecteur, assoupi à l’avant dernière ligne du premier paragraphe. Ah! la chute! Bien obligée! plus conventionnelle que la poignée de mains de condoléances à la sortie du cimetière. Je dois reconnaître que les nouvelles les plus désespérément plates se débrouillent tout de même pour redescendre un peu plus bas par le deus ex machina de la chute. On ne leur aurait pas imaginé autant de ressort! Mais si, elles font de leur mieux et parviennent à se prendre une dernière fois les pieds dans le tapis pour la grand guignolesque chute.
J’avoue que je me passerais bien de tous ces gadins qui ne me font même plus sourire, moi qui ai pourtant un tel fonds de gaieté naturelle. Cela m’évoque immanquablement Belle. C’était son nom, pour une fois je n’invente rien! Belle, cette noble dame de Chicago qui avait coutume, dans les dîners formels, au moment du dessert, de sortir un mignon carnet en maroquin pour nous lire le choix du jour de son florilège d’histoires drôles. La blague hissée au rang de lecture sainte. A la fin, après un silence tactique admirable où elle posait sur chacun des convives les cent yeux de la déesse Junon: «Wait! Ce n’est pas fini! c’est maintenant que vous allez rire!». Et la chute annoncée par les royales trompettes tombait comme la hache sur la tête d’Ann Boleyn.
Comme s’il suffisait d’appliquer cette recette grossière pour écrire une nouvelle! J’entends une bonne nouvelle. Autre chose qu’un court récit à chute. Non, définitivement, aux nouvelles qui chutent, je préfère celles qui s’envolent, pour lesquelles la fin ne tombe pas comme un effet de surprise convenu et mille fois anticipé, mais à la manière d’une illumination, comme si, d’un coup, on appuyait sur l’interrupteur et que l’histoire tout entière s’éclairait par la grâce de cette lumière au bout du couloir.
Le courant, nous y sommes, il faut que quelque chose passe. C’est le critère fondamental que retient Baudelaire, celui de la tension permanente «dans la composition tout entière, il ne doit pas se glisser un seul mot qui ne tende, directement ou indirectement à parfaire le dessein prémédité.»
Nabokov affirmait lui aussi que le roman possède une tension que la vie n’a pas, alors que dire de la nouvelle, ce mini roman plus chargé d’énergie qu’une pile électrique! Car la nouvelle va vite, va loin. Elle est fille de l’audace et de la vélocité. Le temps d’une plongée en apnée et on ressort les yeux éblouis, la tête bourdonnante. On a entrevu un peu de la vie insoupçonnée des grands fonds. Pourtant, la nouvelle est modeste, elle ne prétend pas créer un monde, comme le roman, mais juxtaposer des visions, des sketches, des sensations. Elle ne développe pas, ne pèse pas, elle passe. «Un éclair, puis la nuit» comme la mystérieuse passante du poème de Baudelaire, elle emporte avec elle une vie, dix vies et notre âme de lecteur.
Oui la nouvelle est modeste et quoi de plus modeste qu’un recueil collectif? de moins ramenard? de plus démocratique? Le nôtre se veut de plus égalitaire, couchant, sans prééminence, huit auteurs sous la même couverture. Pour eux aussi, il s’agit d’un passage à l’acte, celui d’écrire, puis celui de publier. Je crois que c’est primordial. La fiction n’est pas une écriture autocentrée, elle n’est ni une exploration intime, ni une thérapie, elle est faite pour être lue. En se mettant à exister dans la cervelle des lecteurs, en se «réalisant», les personnages donnent naissance véritablement à l’auteur.
Et maintenant, ami flâneur du siècle XXI, à vous de lire! Passez à l’acte!
La frontera
Cliquez pour agrandir
 La frontera
La frontera
Éditions Lettres frontière
Publié en 2013 dans un ouvrage collectif à l'occasion des 20 ans de Lettres frontière.
Je ne l’ai d’abord entendu appeler que frontera. Elle se tenait, terrible, entre la France et l’Espagne, comme un de ces démons qui jettent l’épouvante, non seulement dans l’esprit des enfants, mais des grandes personnes. Puisque mon père n’en parlait qu’avec un frisson dans la voix.
La frontera c’était le lieu mystérieux où il nous conduisait dans la voiture surchargée de valises, maman, mes frères et sœurs et moi pour nous mettre dans le train. Gare de Cerbère. A dix ans, j’imaginais le monstre qui gardait les enfers. Et il devait bien y avoir l’enfer de l’autre côté de cette ligne interdite que mon père n’avait pas le droit de traverser. Il s’en retournait seul après d’ultimes recommandations: on donnerait à ses sœurs ces lettres enluminées de dessins et de poèmes, on saluerait sa mère, la tombe de sa mère et on n’oublierait pas de lui rapporter le fromage Manchego et le pain. Surtout le pain, lourd et blond, pareil à sa terre que lui, l’impie, l’iconoclaste, mangerait religieusement, découpant de fines tranches de son canif comme s’il s’incorporait l’âme de son pays.
Et après le départ du train, il reprendrait le volant pour rôder encore sur les petites routes des Pyrénées, longeant autant qu’il pouvait l’interdite frontière, avant de remonter à Lyon. Car je compris très vite que de l’autre côté commençait la terre de mon père, et qu’elle lui était, à lui seul, interdite. Il lui fallut attendre que Franco amnistie les prisonniers politiques en 70 pour y retourner.
De l’autre côté de la frontière, c’était un autre univers. La terre était plus rouge, plus âpre, la lumière plus intense, les couleurs exaspérées comme des piments, les sons résonnaient autrement dans la riche vocalisation de la langue. Et les odeurs! Les yeux fermés pour humer violemment le grand corps de l’Espagne, parfum rauque de ciste sec et goulées fraîches des cafés sombres comme des puits sous les arcades,qui sentent l’anchois et l’anisette et le carrelage lessivé à grands seaux d’eau. Sans doute, les humains étaient autres de l’autre côté de la frontière. La traverser le temps des vacances, c’était pénétrer dans l’étrangeté même, le dernier bastion des dictatures fascistes, l’Espagne franquiste. Qu’on se le dise! c’est pourquoi elle était gardée par des hommes en armes vêtus de vert dont les incroyables casques en celluloïd, entre le chapeau de torero et celui du Jedi de la guerre des étoiles, jetaient des éclats noirs: la guardia civil aussi terrifiante que dans les poèmes de Lorca.
C’était une frontière fermée, armée, faisant face à l’ennemi, au sens étymologique du terme: le front. J’en ai passé tant d’autres depuis, dont je conservais orgueilleusement les coups de tampon sur mes passeports comme autant de trophées: Liban, Jordanie, Syrie, Egypte, Arabie. Ce Moyen Orient couturé des frontières politiques laissées par la chute de l’empire ottoman. Ça a beau être la même langue, la même culture, cousinages belliqueux cependant. Querelles de famille.
Frontières défensives, bouclier levé contre l’autre, le frère maudit. Chacun voit Caïn derrière sa frontière.
Se peut-il que la frontière soit inscrite profondément et de manière indélébile dans notre humanité? Que la frontière soit ce qui nous fonde, limite et matrice à la fois? Enceintes de pierres, de fer ou de béton armé, grande muraille de Chine, murs de Berlin, de Gaza, du Mexique, barrages contre l’immigration, murs de la peur, murs de la haine, murs de la honte. La frontière, scarifiée sur le sol, sur les cartes et jusque dans les toponymies.
Juillet 2013, je suis à Palos de la Frontera, dans cette Andalousie où le mot «frontera», régulièrement accolé aux noms des bourgades - Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Vejez de la Frontera – rappelle la reconquête obstinée, poursuivie au fil des siècles. Les Maures repoussés au-delà d’une ligne toujours mouvante, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à reconquérir: 1492, chute de Grenade. Enfin chez soi. Entre Espagnols. Isabel et Ferdinand, les rois catholiques. Mais voilà, la même année, il y eut Colomb et la conquête de l’Amérique, nouvelle frontière, non plus dans le sens de refuge mais d’ouverture, confins du monde sans cesse repoussés. Colomb, parti du petit village de Palos de la Frontera après sept ans de tractations pour convaincre Isabel. Cette fois la reine ne s’était pas mis les mains sur la tête en lui disant «Ay! Colomb, tu es fou, retourne d’où tu viens!». Non elle lui avait accordé le dinerito, restait à trouver l’équipage, des hommes assez cinglés pour s’embarquer avec lui dans cette aventure suicide. Pensez, le bout du monde pour ces matelots ignares, plus habitués au maniement de la charrue que de la grand voile, tremblants à l’idée que la mer brusquement s’arrête et dégringole en une cosmique cataracte, puisque bien sûr la terre était plate comme une hostie!
Palos de la Frontera oublié de l’histoire, le village du prodige, le port minuscule qui a découvert le nouveau monde et d’où la mer s’est retirée. La crique, à présent ensablée, n’abrite plus qu’une station service à l’emplacement précis où étaient amarrées les trois caravelles.
C’est là, qu’après avoir visité le monastère de la Rabida qui hébergea Colomb, je fais le plein, en pensant aux marins qui y firent l’aiguade avant de partir. Ce soir, à la terrasse d’un café, j’attends que la vraie nuit s’installe avec ses étoiles rieuses qui sentent le jasmin et sa pleine lune de Ramadan. Le même ciel qui salua Colomb, un ciel au-delà des frontières et du temps. Vers minuit des autocars de ligne déchargent leurs cargaisons de passagers aux yeux las.
Commence alors une noria d’arrivées et de départs qui durera une partie de la nuit. Pas des touristes étrangers, ni des voyageurs espagnols, ces hommes et ces femmes, jeunes pour la plupart qui s’éloignent d’un pas chancelant, ankylosés par les trois jours de car, ce sont des travailleurs roumains. L’Espagne en crise reste encore l’Eldorado des miséreux de l’Est qui sarclent les champs, cueillent les fraises, servent dans les bars pour une poignée d’euros.
Il fallait que les frontières intérieures de l’Europe s’effacent pour que ce patelin devienne leur dernière frontière. La pointe extrême du vieux continent n’est plus le promontoire, la rampe de lancement vers le nouveau monde, mais la destination ultime de ceux qui n’ont plus rien. Le retour de bâton sarcastique de l’histoire, ce que les Anglais appellent poetic justice. Mais Palos ne signifie-t-il pas bâton? Sur les autocars rouges l’inscription Bucarest- Roma- Genova -Palos épaterait bien Colomb, le Génois!
Les ailes du bizarre
Le mot vous bourdonne à l'oreille comme un vol lourd de frelon, vous interpelle, vous importune. Un malaise dont on ne se défait pas d'une tape. Un danger.
Car il y a d'abord la vibration des sons: le "biz", la bise, le baiser des labiales, puis la dentale sur laquelle la pointe de la langue vient siffler. L'éclair du Z, matrice du bizarre. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire à la lettre Z, porte étroite du club très select, réservé aux mots VIP, où le zénith côtoie le zèbre, le zoo, le zeugma, le zélote et l'imprédictible zigzag. Je reste fidèle aux surprises du Z accroché comme le grelot du serpent crotale à la dernière lettre de mon nom: Fernandez. Sifflez serpents, tressés en couronne au-dessus de nos têtes!
A des lecteurs qui me demandaient pourquoi j'avais appelé l'héroïne de la Servante abyssine, Zinesh, je me souviens avoir répondu: "parce que de tous les prénoms Erythréens c'était le plus bizarre". Une raison suffisante.
Le bizarre ne se définit pas. Comment se conformerait-il à une définition? Il est le non conforme. Le bizarre, c'est ce qui résiste. Qui échappe aux représentations et loin de vous laisser la sensation étrange, mais réconfortante, du déjà vu, de l'anamnèse, il vous claque au nez son incongruité de jamais vu. Le bizarre ne se laisse pas identifier. Comment le reconnaîtrait-on? Il n'a pas son semblable. Il ne ressemble à rien. C'est ce qui inquiète, cette charge obscure de mystère. Les terreurs du fantastique ne sont pas loin.
Le bizarre est inclassifiable, il est contamination, hybridation, déséquilibre, vertige qui fait vaciller les catégories du juste, du bon et du beau. Du beau parlons-en. Les déclarations de Baudelaire, convaincu que le "beau est toujours bizarre", au-delà de la provocation du dandy à la veste au col d'entonnoir, prompt à épater le bourgeois, du décadent et de l'amoureux de la modernité, nous rappellent le traducteur de Poe qui sut restituer le comique luciférien de "l'ange du bizarre".
Le bizarre piège le rêve et l'ombre, c'est ce que revendiqueront les Surréalistes, apôtres du bizarre. Breton dans son Anthologie de l'humour noir dresse catalogue des arpenteurs de ces terrae incognitae du bizarre où le rire se fait grimace - ou le contraire -; où l'imagination s'affirme résolument comme la folle du logis, défilé de bien jolis monstres qu'on croirait échappés des toiles de Bosch, nous soufflant que le bizarre serait fils de Folie. De Folie, mais aussi de Liberté.
Cliquez pour agrandir
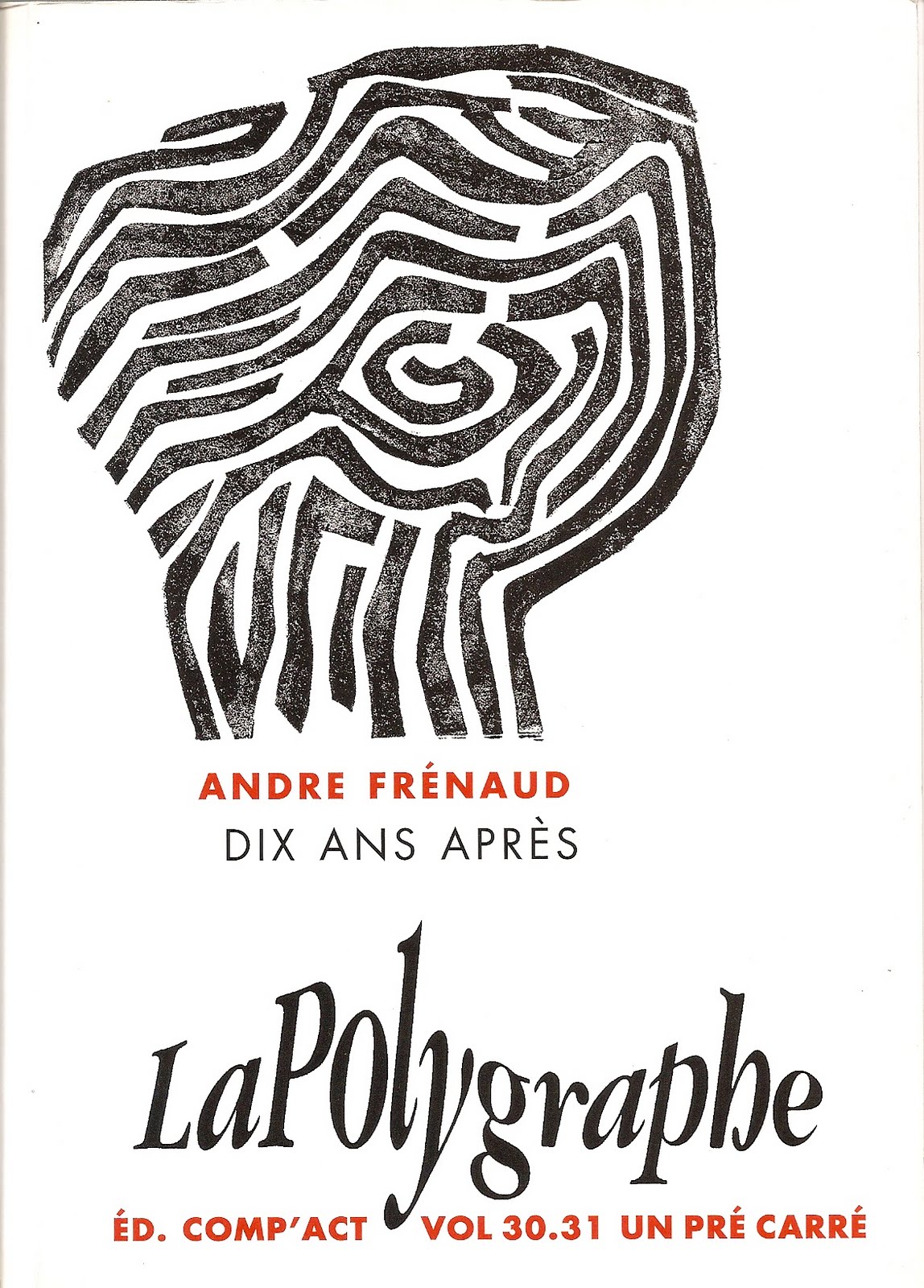 Noces de sable
Noces de sable
Chronique Revue LA POLYGRAPHE, n°-30-31 - 2003
Encore un papier écrit en courant, ou en dormant, ce qui fait montre du même irrespect envers le lecteur. Inaugurons une nouvelle forme d’écriture: l’écriture couchée, sans feuille ni crayon, l’écriture pur jus «de la pensée accrochant la pensée et tirant», mais pas trop. On ne me tirera pas du lit si facilement. Infini l’espace qui me sépare de ma table de travail – nom terrifiant: «table de travail»! de torture, d’accouchement, meuble où l’on est soumis à la question – aucun risque! de mon lit les moines inquisiteurs n’approcheront pas. Pace!
L’écriture oreillers, duvets d’oisillons et pas une seule plume d’oie à la main, l’écriture odalisque! C’est que j’ai été longtemps, et avec ferveur, odalisque (le lecteur sagace à qui on ne la fait pas ne me croira jamais, tant pis pour lui, la méfiance dissipe tous les éblouissements). Bien loin, à l’intérieur des terres, à l’est de la Méditerranée, plein sud, à hauteur du tropique du Cancer: le désert. Ici et là les quadrillages monstrueux qu’un enfant schizophrène aurait tracés sur le sable : les villes. Mais tout passe et tout lasse, surtout le désert où l’on attend avec impatience une chute de météorites, une nouvelle guerre du Golfe pour rompre la monotonie. Il y a beau temps que j’ai rendu mon tablier d’odalisque ou plutôt mes pantalons bouffants de gaze rose. Eh, diable! Les primates ont beau avoir les bras forts longs, la revue La main de singe n’atteignait pas ma capitale des sables.
En fait, à part quelques journaux rendus borgnes par les marqueurs de la censure – ah! les pin-up barbouillées de noir jusqu’au cou et dont les visages au sourire d’émail inaltérable arboraient désormais le rictus du décapité! – et quelques magazines rendus légers, délestés d’un bon paquet de pages interdites et arrachées sans ménagement – restaient la couverture et les publicités automobiles -, rien, pas plus de revues littéraires que sur le tapis de prière d’un Imam. Mais c’est là que nous sommes, très précisément et que le tapis déroule toujours le même motif, ad eternam. Ai-je assez fouillé les rayonnages des librairies de ma ville des sables! Le tour était vite fait. En alphabet latin, le seul que je puisse lire sans ébahissement, bien peu de choses. Pour le français, les œuvres incomplètes de Roger Garaudy, postérieures à la dernière conversion religieuse en date, cela s’entend. La bonne. Celle où la faucille se change en croissant et le marteau en sabres croisés. Et il a intérêt, le pèlerin! Les jeux de l’amour et du hasard de la foi ne sont pas de mise à l’est de la Méditerranée et l’apostasie reste punie de peine de mort. Tu te repens, on te pend! Italien, allemand, espagnol, rien à glaner hormis des livres de cuisine orientale et des pamphlets religio-hygiéniques traduits en toutes les langues de Babel et publiés aux frais de la cassette royale. Mais Shakespeare! Chose inconcevable et qui eût émerveillé Borges, Shakespeare – prononcer Cheikh Espirrrr – avait été miraculeusement épargné. Ils y étaient tous ces furieux rois anglo-saxons: le roi Lear, Richard II et Richard II et les Henry, et le neurasthénique prince danois et Antoine et Cléopâtre, et… tout Shakespeare à dévorer. Il y fallait un sacré appétit!
Les journaux locaux, riches de toutes leurs pages, eux, vierges de tout outrage au marqueur noir, étalaient leur sempiternelles ronde de vieillards en robe blanche, à la barbichette teinte à l’identique, posant la première pierre, indifféremment, d’une école, d’un aéroport, d’un ministère, en tenant une truelle étincelante comme une pelle à gâteau Puiforçat. Les journaux pesaient du poids de toutes ces nouvelles qu’ils n’annonceraient pas.
Devant les centres commerciaux les limousines défilent silencieusement dans la nuit moite, déversant au passage leur lot de femmes empaquetées dans des voiles noirs. Mains petites, alourdies de bracelets et parfums violents. Les enfants dans leurs petits vêtements d’adultes qui sentent le neuf s’échappent du nuage noir maternel, tels des sauterelles vibrionnantes. La ville resplendit comme les cascades d’or sur les vitrines des orfèvres. Chaque villa est une couronne dont les murs d’enceinte s’illuminent de boules magiques à la tombée de la nuit, chaque villa est une forteresse cerclée de murailles hautes de trois mètres, et chaque femme est un trésor et chaque femme est une forteresse. Mais où est le désert? Où le grand large? Où le vent qui peigne les dunes, recouvre et dévoile tour à tour d’autres villes, nabatéennes ou hémyarites, villes en ruine dont nul ne parle, peut-être furent-elles construites par le roi Gian Ben Gian qui édifia les pyramides de Guizeh, selon les légendes arabes, ou bien par les génies pour la reine de Saba?
C’est là sans doute que commence le pays d’Isabelle Eberhardt, car le désert est partout le même, de l’Afrique à la Mongolie, les sables communiquent entre eux comme les puits artésiens du Vaucluse, et c’est toujours le même sable et ce sont toujours les mêmes rêves.
«D’autres pérégrinations, d’autres rêves et d’autres griseries de soleil dans le silence et la magie d’autres déserts, plus âpres et plus lointains, ont passé sur ces choses d’alors. A l’horizon, dans quelques jours peut-être, s’il plaît à Allah, je vais de nouveau m’en aller et ce sera encore vers le morne Mogh’reb de mystère et de mort que j’irai… A pareille date, dans un an, existerai-je encore, et où serai-je?»1
Isabelle sait de tout temps, depuis qu’elle s’est promise au désert, qu’elle scellera un jour ses noces de sable avec la mort. Noces atroces, noces ironiques, noces d’eau et de boue quand le ciel et la terre déversent leurs torrents d’eau et de sable dans un rut échevelé sur l’Ouadi d’Aïn Sefra. Isabelle, noyée au désert! Comment ignorer que le désert et la mort ont malignement partie liée? Ils le savent bien tous, les Rimbaud, les Monfreid, et ils peuvent bien se camoufler derrière d’inavouables trafics, armes ou esclaves: vendre, acheter, troquer, compter, peser, tenir des registres… Pour mieux occulter l’indicible, qui est de tester jusqu’où l’on pourra descendre, degré à degré, dans la fournaise!
Isabelle passe, tenant sa chamelle par la bride. Elle a du mal à avancer, tant les sables mouvants de mon lit se font traîtres, la couette enfle, telle une dune démesurée et Isabelle grimpe, haletante, tirant sur les draps qui viennent s’entortiller à ses chevilles. Mon lit devenu circulaire, vaste comme le Rub El Khali, livide comme le Nefud, vacille, inondé de lune. Isabelle au milieu, si proche que je la distingue parfaitement, avec sa bouche très rouge d’enfant et ses joues veloutées où s’accroche le sable, si proche, mais pourtant à des années lumière… Elle a beau marcher, il ne peut se faire qu’elle ne reste toujours au milieu. On est toujours au centre du désert. A côté, sans la voir, chemine Rimbaud, ainsi qu’elle, sa sœur Isabelle, drapé de blanc : drap, djellaba, linceul, étoffes qui mettent à la voile et dont sont tissus les rêves. Mais voilà que le sable bleuit et se soulève et scintille. La Mer Rouge d’Henri de Monfreid, je la connais bien, c’est elle qui baignait la ville blanche où s’asphyxiait mon enfance nubile, autrefois… Nous avions si peu à nous dire! Elle ne pouvait me parler de lointains, d’Indes occidentales à découvrir, comme l’Atlantique de mes ancêtres conquistadores, elle n’avait pas la transparence et la gaieté festivalière de la Mer Méditerranée, elle ne pouvait même, comme la Mer d’Oman évoquer les éternels départs de Sinbad. Non, la Mer Rouge était une mer trop chaude, fatiguée, sans mouvements ni marées, une mer sans rivages, suffocantes sous les odeurs poivrées d’Afrique et du Yémen, oubliée de l’histoire, le trou du cul du monde!
Ce sable et cette eau et ce lit! Serions-nous en Enfer, lieu de convergence de tous les désirs, de toutes les ferveurs? C’est là le seul Orient sans doute, là où ne mènent pas les «tours» qui, depuis l’aube du XIXè siècle promettent le «voyage en orient». Cohorte d’artistes voyageurs: Lamartine, Chateaubriand, Maxime du Camp, Fromentin, Delacroix, Gautier, Flaubert, la liste serait interminable… Tous partent pour revenir, évitant soigneusement l’attraction de l’enfer, même Nerval, se réservant pour plus tard les noces avec la folie et la mort, même Loti dont les noces n’intéresseront que les sens, mais si peu l’âme. Tous partent pour revenir, hormis quelques fous, quelques saints anachorètes, quelques damnés, une Isabelle aussi fervente que Thérèse d’Avila. Quant à moi, rescapée de la grande fournaise, j’ai conservé mon Enfer portatif, finalement heureuse de ce désenchantement. Je peux désormais faire miennes ces paroles de Nerval, l’amertume en moins:
«Moi, j’ai perdu royaume après royaume et province à province, la plus belle moitié de l’univers, et bientôt je ne vais plus savoir où réfugier mes rêves; mais c’est l’Egypte que je regrette le plus d’avoir chassée de mon imagination pour la loger tristement dans mes souvenirs.»2
D’Egypte on revient toujours, ami Gérard, - l’Egypte est un pays hautement civilisé, plus vallée que désert, ne s’y ensabla qu’un vieux sphinx -, mais on se sauve plus difficilement de ces territoires à l’Orient de l’Egypte, à l’est de la Méditerranée. De là-bas, si on réchappe, on revient sans certitude, mais avec des matériaux hétéroclites, prêt à rebâtir les seules constructions qui bravent le temps: les citadelles du rêves. Heureux d’avoir miraculeusement, deux fois vainqueur, traversé l’Achéron.
1Lettres et journaliers, Alger, 8 avril 19004, Isabelle Eberhardt, Actes Sud, 1987.
2Lettre à théophile Gautier du 7 septembre 1843.