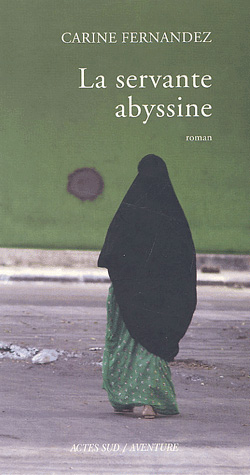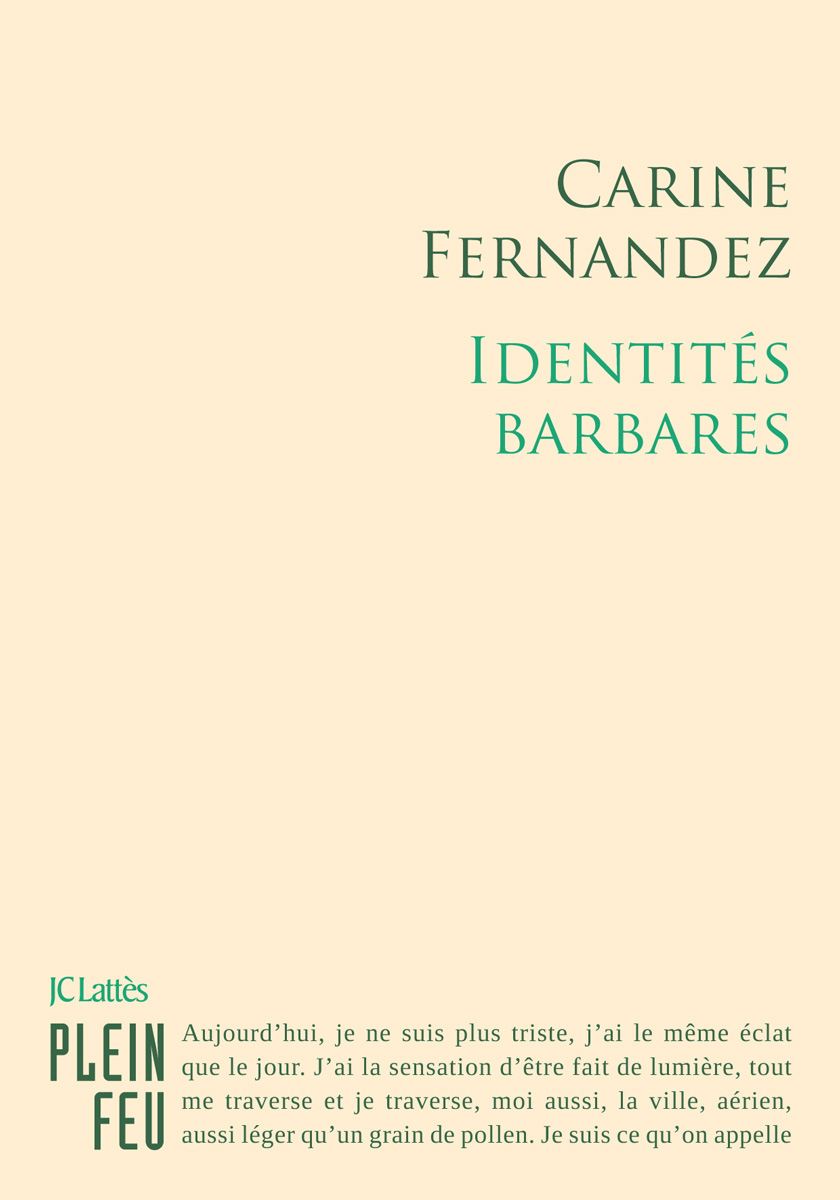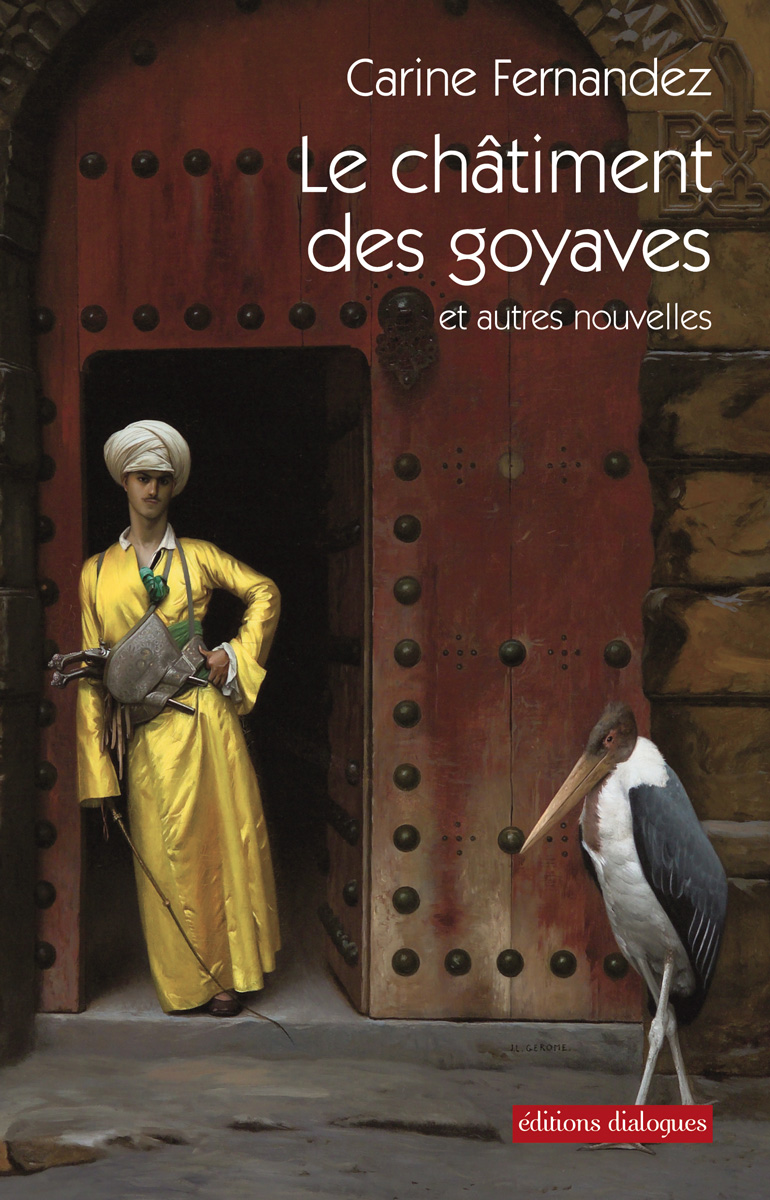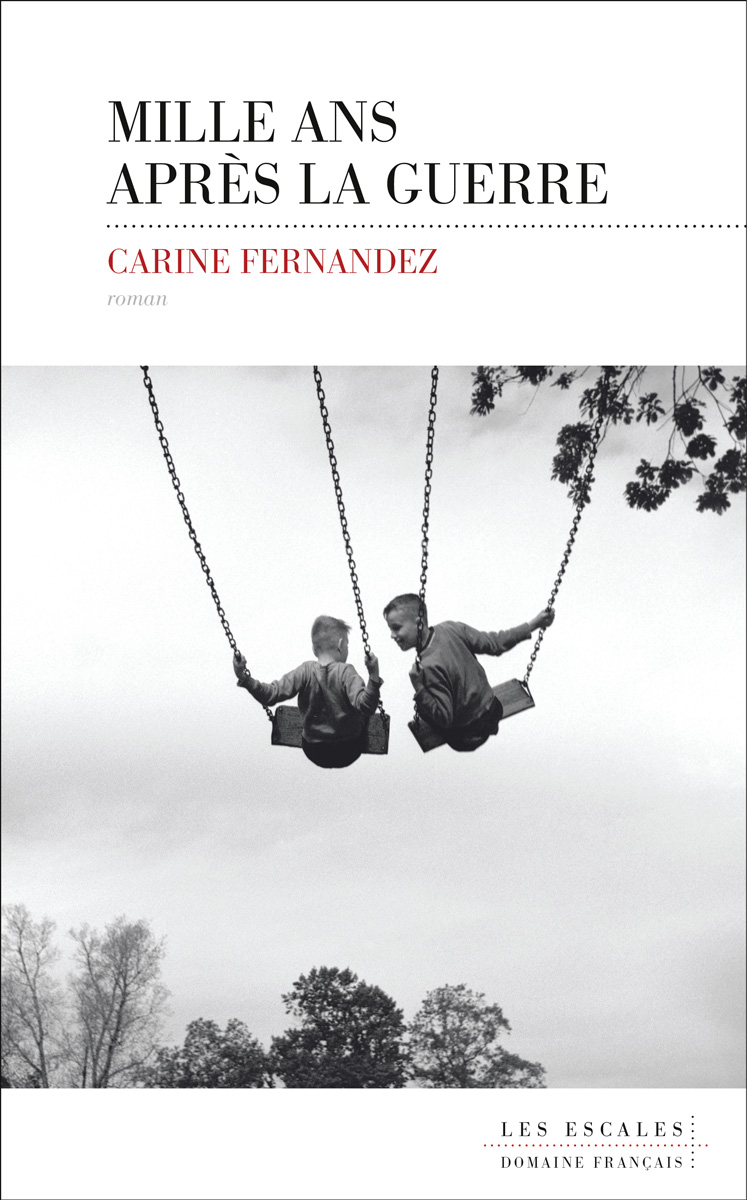Cliquez pour agrandir
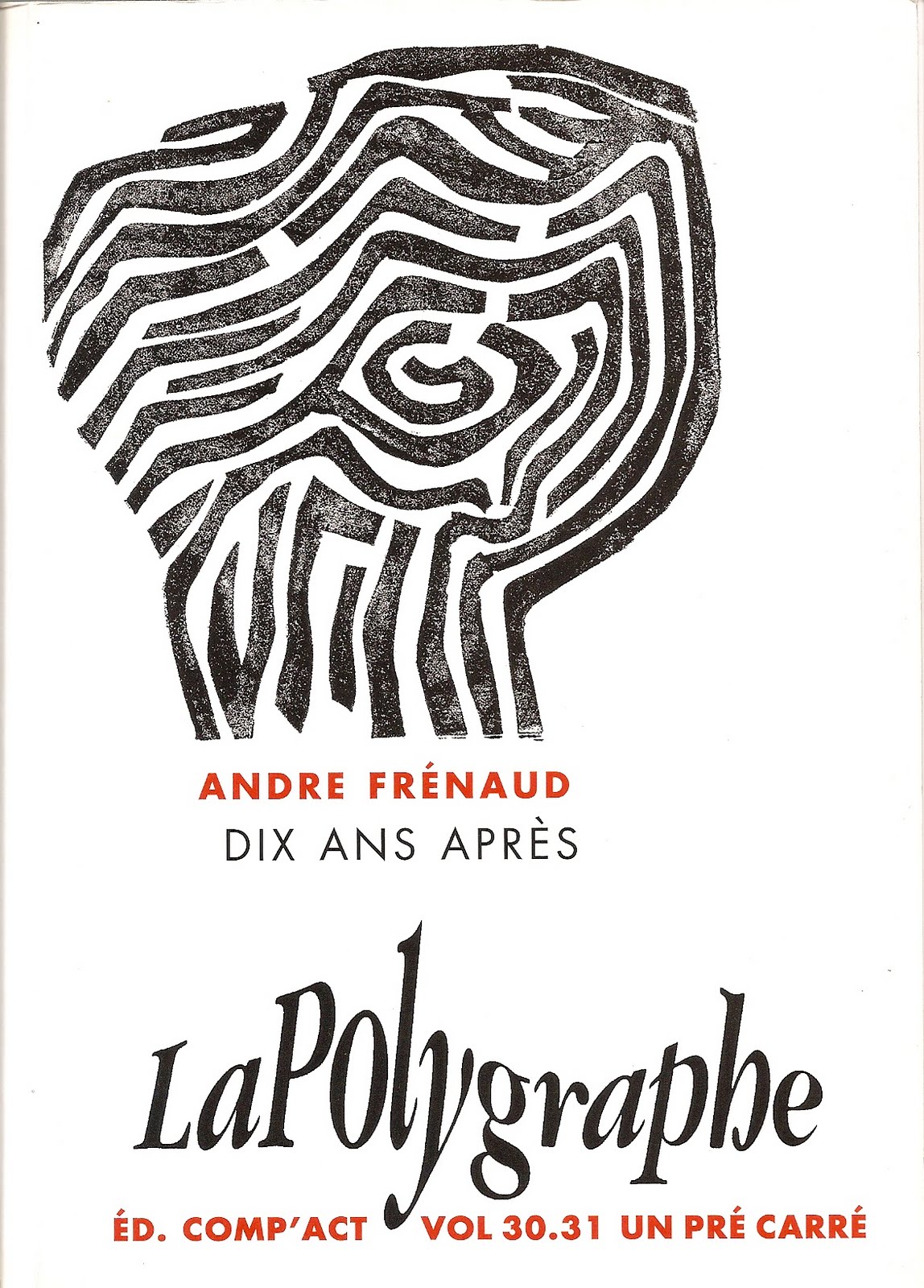 Noces de sable
Noces de sable
Chronique Revue LA POLYGRAPHE, n°-30-31 - 2003
Encore un papier écrit en courant, ou en dormant, ce qui fait montre du même irrespect envers le lecteur. Inaugurons une nouvelle forme d’écriture: l’écriture couchée, sans feuille ni crayon, l’écriture pur jus «de la pensée accrochant la pensée et tirant», mais pas trop. On ne me tirera pas du lit si facilement. Infini l’espace qui me sépare de ma table de travail – nom terrifiant: «table de travail»! de torture, d’accouchement, meuble où l’on est soumis à la question – aucun risque! de mon lit les moines inquisiteurs n’approcheront pas. Pace!
L’écriture oreillers, duvets d’oisillons et pas une seule plume d’oie à la main, l’écriture odalisque! C’est que j’ai été longtemps, et avec ferveur, odalisque (le lecteur sagace à qui on ne la fait pas ne me croira jamais, tant pis pour lui, la méfiance dissipe tous les éblouissements). Bien loin, à l’intérieur des terres, à l’est de la Méditerranée, plein sud, à hauteur du tropique du Cancer: le désert. Ici et là les quadrillages monstrueux qu’un enfant schizophrène aurait tracés sur le sable : les villes. Mais tout passe et tout lasse, surtout le désert où l’on attend avec impatience une chute de météorites, une nouvelle guerre du Golfe pour rompre la monotonie. Il y a beau temps que j’ai rendu mon tablier d’odalisque ou plutôt mes pantalons bouffants de gaze rose. Eh, diable! Les primates ont beau avoir les bras forts longs, la revue La main de singe n’atteignait pas ma capitale des sables.
En fait, à part quelques journaux rendus borgnes par les marqueurs de la censure – ah! les pin-up barbouillées de noir jusqu’au cou et dont les visages au sourire d’émail inaltérable arboraient désormais le rictus du décapité! – et quelques magazines rendus légers, délestés d’un bon paquet de pages interdites et arrachées sans ménagement – restaient la couverture et les publicités automobiles -, rien, pas plus de revues littéraires que sur le tapis de prière d’un Imam. Mais c’est là que nous sommes, très précisément et que le tapis déroule toujours le même motif, ad eternam. Ai-je assez fouillé les rayonnages des librairies de ma ville des sables! Le tour était vite fait. En alphabet latin, le seul que je puisse lire sans ébahissement, bien peu de choses. Pour le français, les œuvres incomplètes de Roger Garaudy, postérieures à la dernière conversion religieuse en date, cela s’entend. La bonne. Celle où la faucille se change en croissant et le marteau en sabres croisés. Et il a intérêt, le pèlerin! Les jeux de l’amour et du hasard de la foi ne sont pas de mise à l’est de la Méditerranée et l’apostasie reste punie de peine de mort. Tu te repens, on te pend! Italien, allemand, espagnol, rien à glaner hormis des livres de cuisine orientale et des pamphlets religio-hygiéniques traduits en toutes les langues de Babel et publiés aux frais de la cassette royale. Mais Shakespeare! Chose inconcevable et qui eût émerveillé Borges, Shakespeare – prononcer Cheikh Espirrrr – avait été miraculeusement épargné. Ils y étaient tous ces furieux rois anglo-saxons: le roi Lear, Richard II et Richard II et les Henry, et le neurasthénique prince danois et Antoine et Cléopâtre, et… tout Shakespeare à dévorer. Il y fallait un sacré appétit!
Les journaux locaux, riches de toutes leurs pages, eux, vierges de tout outrage au marqueur noir, étalaient leur sempiternelles ronde de vieillards en robe blanche, à la barbichette teinte à l’identique, posant la première pierre, indifféremment, d’une école, d’un aéroport, d’un ministère, en tenant une truelle étincelante comme une pelle à gâteau Puiforçat. Les journaux pesaient du poids de toutes ces nouvelles qu’ils n’annonceraient pas.
Devant les centres commerciaux les limousines défilent silencieusement dans la nuit moite, déversant au passage leur lot de femmes empaquetées dans des voiles noirs. Mains petites, alourdies de bracelets et parfums violents. Les enfants dans leurs petits vêtements d’adultes qui sentent le neuf s’échappent du nuage noir maternel, tels des sauterelles vibrionnantes. La ville resplendit comme les cascades d’or sur les vitrines des orfèvres. Chaque villa est une couronne dont les murs d’enceinte s’illuminent de boules magiques à la tombée de la nuit, chaque villa est une forteresse cerclée de murailles hautes de trois mètres, et chaque femme est un trésor et chaque femme est une forteresse. Mais où est le désert? Où le grand large? Où le vent qui peigne les dunes, recouvre et dévoile tour à tour d’autres villes, nabatéennes ou hémyarites, villes en ruine dont nul ne parle, peut-être furent-elles construites par le roi Gian Ben Gian qui édifia les pyramides de Guizeh, selon les légendes arabes, ou bien par les génies pour la reine de Saba?
C’est là sans doute que commence le pays d’Isabelle Eberhardt, car le désert est partout le même, de l’Afrique à la Mongolie, les sables communiquent entre eux comme les puits artésiens du Vaucluse, et c’est toujours le même sable et ce sont toujours les mêmes rêves.
«D’autres pérégrinations, d’autres rêves et d’autres griseries de soleil dans le silence et la magie d’autres déserts, plus âpres et plus lointains, ont passé sur ces choses d’alors. A l’horizon, dans quelques jours peut-être, s’il plaît à Allah, je vais de nouveau m’en aller et ce sera encore vers le morne Mogh’reb de mystère et de mort que j’irai… A pareille date, dans un an, existerai-je encore, et où serai-je?»1
Isabelle sait de tout temps, depuis qu’elle s’est promise au désert, qu’elle scellera un jour ses noces de sable avec la mort. Noces atroces, noces ironiques, noces d’eau et de boue quand le ciel et la terre déversent leurs torrents d’eau et de sable dans un rut échevelé sur l’Ouadi d’Aïn Sefra. Isabelle, noyée au désert! Comment ignorer que le désert et la mort ont malignement partie liée? Ils le savent bien tous, les Rimbaud, les Monfreid, et ils peuvent bien se camoufler derrière d’inavouables trafics, armes ou esclaves: vendre, acheter, troquer, compter, peser, tenir des registres… Pour mieux occulter l’indicible, qui est de tester jusqu’où l’on pourra descendre, degré à degré, dans la fournaise!
Isabelle passe, tenant sa chamelle par la bride. Elle a du mal à avancer, tant les sables mouvants de mon lit se font traîtres, la couette enfle, telle une dune démesurée et Isabelle grimpe, haletante, tirant sur les draps qui viennent s’entortiller à ses chevilles. Mon lit devenu circulaire, vaste comme le Rub El Khali, livide comme le Nefud, vacille, inondé de lune. Isabelle au milieu, si proche que je la distingue parfaitement, avec sa bouche très rouge d’enfant et ses joues veloutées où s’accroche le sable, si proche, mais pourtant à des années lumière… Elle a beau marcher, il ne peut se faire qu’elle ne reste toujours au milieu. On est toujours au centre du désert. A côté, sans la voir, chemine Rimbaud, ainsi qu’elle, sa sœur Isabelle, drapé de blanc : drap, djellaba, linceul, étoffes qui mettent à la voile et dont sont tissus les rêves. Mais voilà que le sable bleuit et se soulève et scintille. La Mer Rouge d’Henri de Monfreid, je la connais bien, c’est elle qui baignait la ville blanche où s’asphyxiait mon enfance nubile, autrefois… Nous avions si peu à nous dire! Elle ne pouvait me parler de lointains, d’Indes occidentales à découvrir, comme l’Atlantique de mes ancêtres conquistadores, elle n’avait pas la transparence et la gaieté festivalière de la Mer Méditerranée, elle ne pouvait même, comme la Mer d’Oman évoquer les éternels départs de Sinbad. Non, la Mer Rouge était une mer trop chaude, fatiguée, sans mouvements ni marées, une mer sans rivages, suffocantes sous les odeurs poivrées d’Afrique et du Yémen, oubliée de l’histoire, le trou du cul du monde!
Ce sable et cette eau et ce lit! Serions-nous en Enfer, lieu de convergence de tous les désirs, de toutes les ferveurs? C’est là le seul Orient sans doute, là où ne mènent pas les «tours» qui, depuis l’aube du XIXè siècle promettent le «voyage en orient». Cohorte d’artistes voyageurs: Lamartine, Chateaubriand, Maxime du Camp, Fromentin, Delacroix, Gautier, Flaubert, la liste serait interminable… Tous partent pour revenir, évitant soigneusement l’attraction de l’enfer, même Nerval, se réservant pour plus tard les noces avec la folie et la mort, même Loti dont les noces n’intéresseront que les sens, mais si peu l’âme. Tous partent pour revenir, hormis quelques fous, quelques saints anachorètes, quelques damnés, une Isabelle aussi fervente que Thérèse d’Avila. Quant à moi, rescapée de la grande fournaise, j’ai conservé mon Enfer portatif, finalement heureuse de ce désenchantement. Je peux désormais faire miennes ces paroles de Nerval, l’amertume en moins:
«Moi, j’ai perdu royaume après royaume et province à province, la plus belle moitié de l’univers, et bientôt je ne vais plus savoir où réfugier mes rêves; mais c’est l’Egypte que je regrette le plus d’avoir chassée de mon imagination pour la loger tristement dans mes souvenirs.»2
D’Egypte on revient toujours, ami Gérard, - l’Egypte est un pays hautement civilisé, plus vallée que désert, ne s’y ensabla qu’un vieux sphinx -, mais on se sauve plus difficilement de ces territoires à l’Orient de l’Egypte, à l’est de la Méditerranée. De là-bas, si on réchappe, on revient sans certitude, mais avec des matériaux hétéroclites, prêt à rebâtir les seules constructions qui bravent le temps: les citadelles du rêves. Heureux d’avoir miraculeusement, deux fois vainqueur, traversé l’Achéron.
1Lettres et journaliers, Alger, 8 avril 19004, Isabelle Eberhardt, Actes Sud, 1987.
2Lettre à théophile Gautier du 7 septembre 1843.