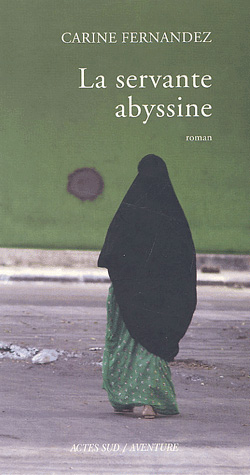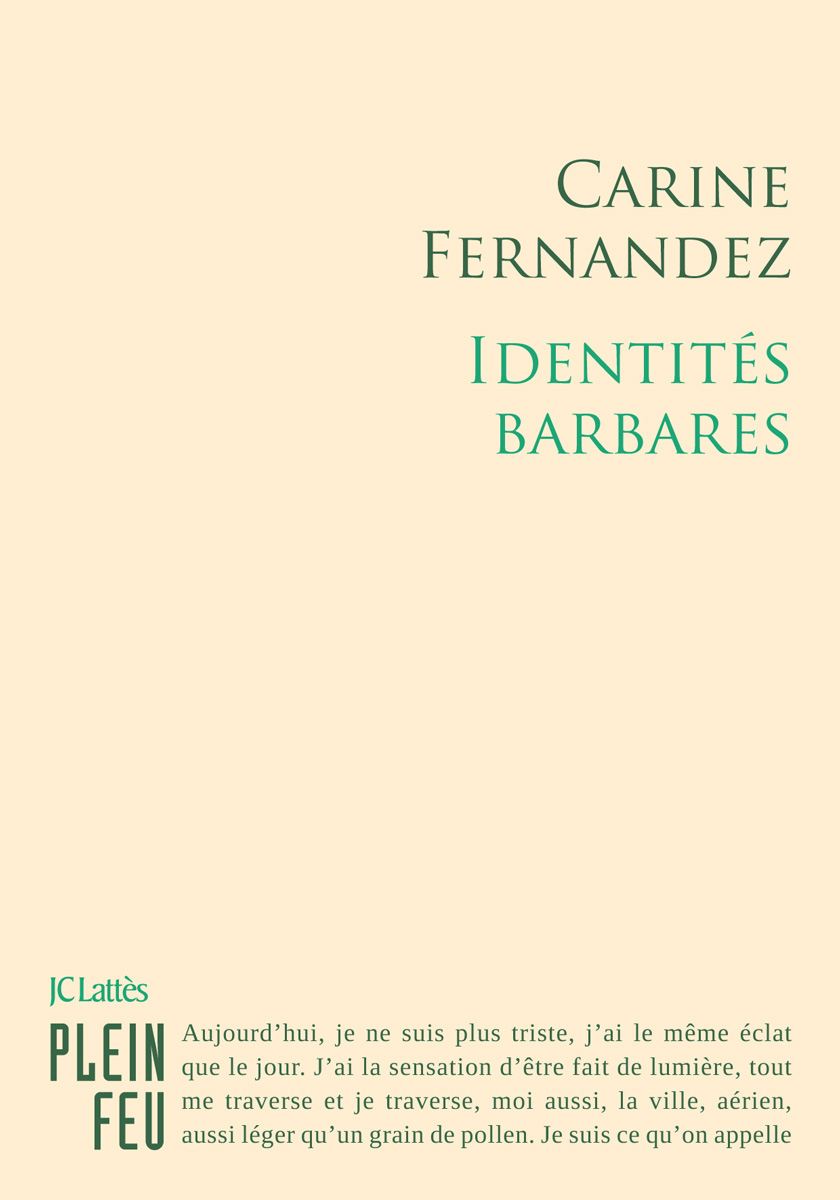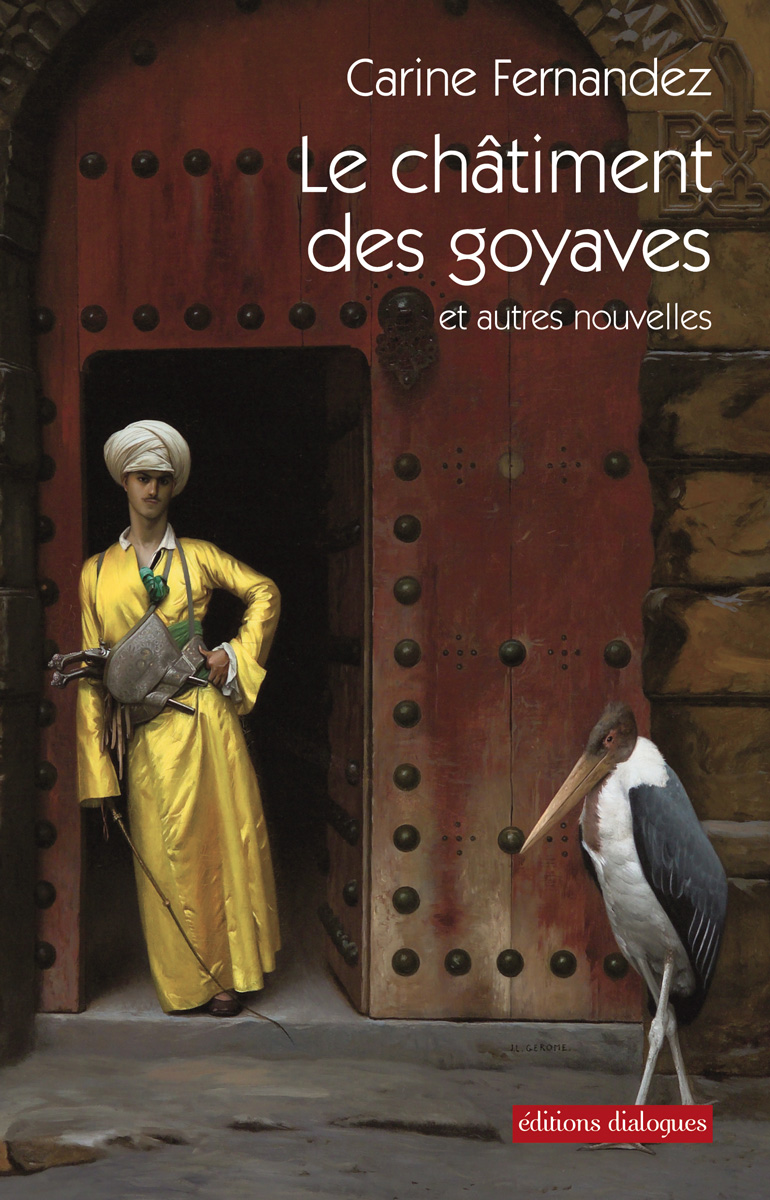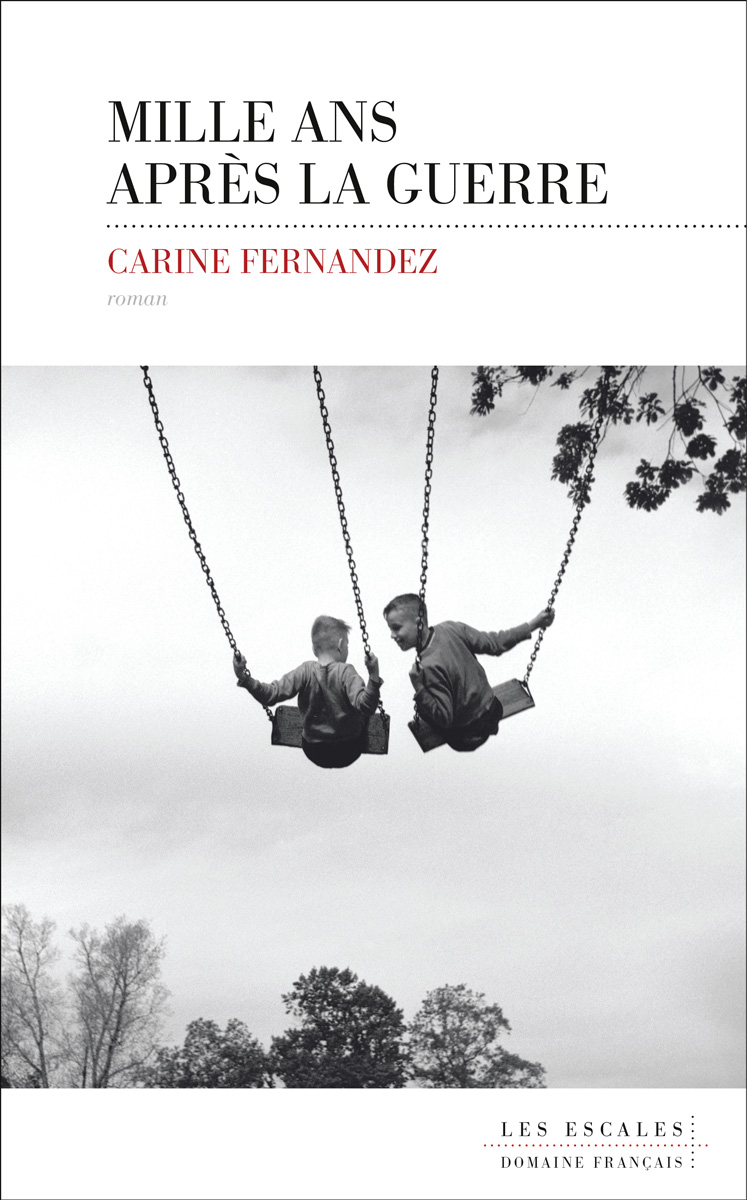Texte donné à la médiathèque de Chambéry pour «Les flashbacks du patrimoine» Automne 2017.
Carine Fernandez retranscrit ici le très ambitieux projet du militaire et historien François de Regnauld, marquis de Lannoy de Bissy (1878-1935), auteur de la première carte générale détaillée du continent africain. Elle nous raconte, aussi, la rencontre entre l'explorateur Jules Borelli et le négociant français Arthur Rimbaud. Devenus compagnons de voyage, ils parcourent ensembles le Harar (actuelle Éthiopie) et tracent les cartes qui serviront au gigantesque projet de Lannoy de Bissy quelques années plus tard.
LA ROUTE DE HARAR
Mon colonel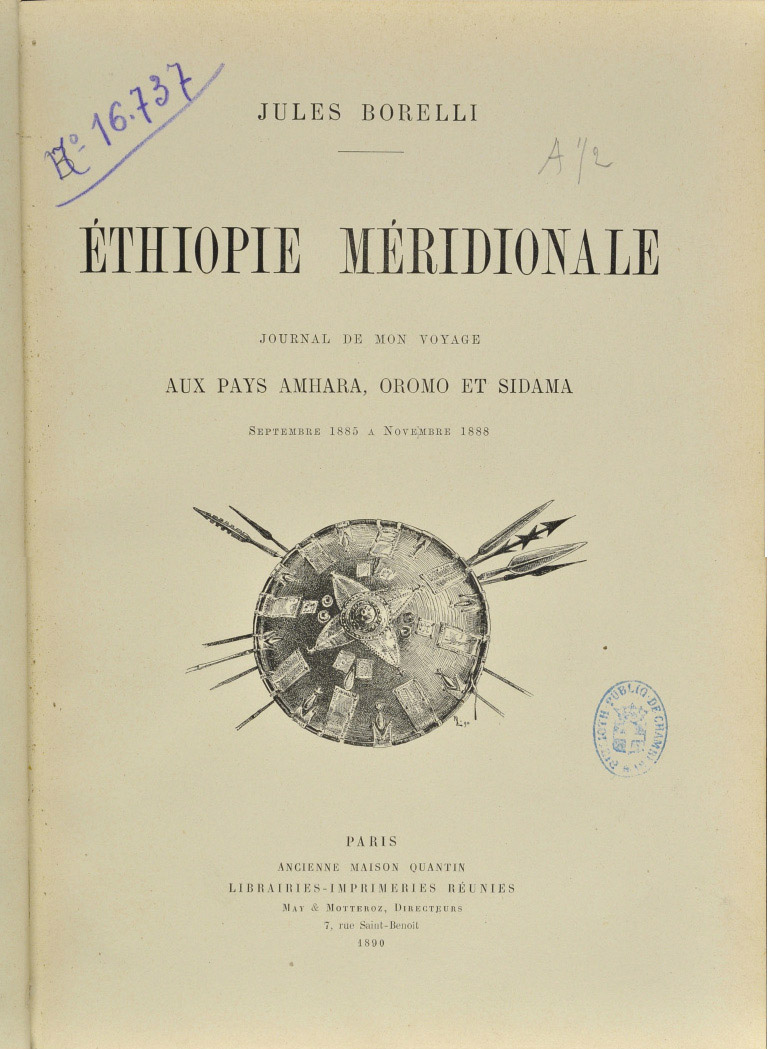 J’ai peu d’usage des militaires et encore moins des capitaines du génie que j’ai le préjugé de croire plus capitaines que génies. Pourtant, me voilà invitée dans la forteresse du capitaine, devenu colonel et grand maître de la légion d’honneur. Quelques jours dans l’intimité de Richard de Regnault de Lannoy de Bissy (1844 -1906). Je ne fréquente que des militaires morts. Le personnage repose au plus profond de la bibliothèque de Chambéry, dans les travées du fonds ancien, avec son bicorne à plumes, ses moustaches relevées en croc de sanglier et son armée de papier : le fonds «Lannoy de Bissy», légué à la ville par son fils. Il faut dire que le colonel mania davantage le crayon que le sabre, ce qui le rend illico plus avenant. Voilà qu’un soir de 1874 , alors qu’il quittait l’Algérie après six ans à tracer des routes et cadastrer le désert, debout sur le pont du navire, regardant s’éloigner les falots du port, - rien n’empêche d’imaginer notre capitaine posant en héros romantique - lui vint cette idée prodigieuse: établir la première carte complète d’Afrique. Une idée épatante vraiment, sans laquelle nous ne nous serions jamais rencontrés. J’ai un faible pour les géographes.
J’ai peu d’usage des militaires et encore moins des capitaines du génie que j’ai le préjugé de croire plus capitaines que génies. Pourtant, me voilà invitée dans la forteresse du capitaine, devenu colonel et grand maître de la légion d’honneur. Quelques jours dans l’intimité de Richard de Regnault de Lannoy de Bissy (1844 -1906). Je ne fréquente que des militaires morts. Le personnage repose au plus profond de la bibliothèque de Chambéry, dans les travées du fonds ancien, avec son bicorne à plumes, ses moustaches relevées en croc de sanglier et son armée de papier : le fonds «Lannoy de Bissy», légué à la ville par son fils. Il faut dire que le colonel mania davantage le crayon que le sabre, ce qui le rend illico plus avenant. Voilà qu’un soir de 1874 , alors qu’il quittait l’Algérie après six ans à tracer des routes et cadastrer le désert, debout sur le pont du navire, regardant s’éloigner les falots du port, - rien n’empêche d’imaginer notre capitaine posant en héros romantique - lui vint cette idée prodigieuse: établir la première carte complète d’Afrique. Une idée épatante vraiment, sans laquelle nous ne nous serions jamais rencontrés. J’ai un faible pour les géographes.
Il aura fallu ce départ et la mort de Livingstone quelques mois auparavant pour faire naître ce projet. Lannoy de Bissy fera la carte que Livingstone ne fera plus. L’explorateur anglais élevé au statut de mythe vivant, disparu trois ans dans la jungle alors qu’il cherchait les sources du Nil, avait été retrouvé au milieu d’une tribu par le journaliste Stanley. Et là, pour la plus grande joie de la postérité et des lithographes qui immortaliseront la scène, Stanley ôte son chapeau et prononce la phrase aussi fashionable qu’apocryphe: «Dr. Livingstone, I presume?». Livingstone se fend d’une courbette, mais refuse de retourner à la «civilisation», en dépit du champagne apporté par Stanley dans sa musette pour fêter les retrouvailles. Il reste pour achever son œuvre, c’est son œuvre qui l’achèvera.
Tous les itinéraires de Livingstone, Lannoy les a arpentés. Sur le papier. S’il s’incline devant le héros, chapeau bas comme Stanley, il fronce le nez devant le géographe. Ses cartes de détail sont bien trop sommaires! Quant à la carte d’ensemble, elle est ridiculement réduite, impraticable ! Lannoy serait plutôt un anti-Livingstone. Il ne plongera pas dans les tréfonds du continent noir, au contact de la terre et des populations comme l’explorateur missionnaire, non, c’est des profondeurs douillettes de sa chauffeuse capitonnée, bien à l’abri en France, qu’il dessine son Afrique, une Afrique mentale.
25 ans plus tard, il a la carte, un atlas en 63 feuilles à l’échelle 1/ 2 000 000, la carte et la légion d’honneur! Il a gagné son pari! Une entreprise folle, jamais tentée auparavant. Le grand corps de l’Afrique, mis à plat sur la table du cartographe. Tout répertorier, cataloguer, s’approprier dans une fringale insatiable. Lannoy annexe ses territoires de papier, patiemment, zone après zone. Un Alexandre des écritoires. Le soldat géographe est mis en disponibilité pour se consacrer uniquement à sa carte, à temps complet, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, deux tours au cadran de sa montre à gousset, qu’il ne retire même pas pour la poser sur la table de nuit. Quand est-ce qu’il dormirait? Il lui faut diriger ses troupes de géographes, voyageurs, militaires, disséminés aux quatre coins de l’Afrique avec lesquels il échange des centaines de lettres. Maître d’œuvre du projet, rien n’échappe à son lorgnon à monture dorée. Pas un chemin tracé dans la brousse qu’il n’en soit informé. Lannoy a ses hommes sur le terrain, ses cartographes et ses savants dans les sociétés de géographie, il est seul au centre de ce réseau international, à collecter ses données, un siècle avant internet, tel Dieu au centre de sa création. Seul à inventer un continent. A défaut d’arpenter le territoire, comme Livingstone, Lannoy arpentera la carte.
L’encartement du monde
La carte et le territoire , belle formule, empruntée à Houellebecq - aux titres souvent meilleurs que le contenu, - qui l’ avait lui-même empruntée sans vergogne à un obscur romancier, lequel reprenait l’expression de Korzybski,: «la carte n’est pas le territoire». Sans doute, mais prise de possession mentale du territoire. L’origine de la carte est politique, elle a partie liée avec le pouvoir, partant avec l’armée. La première carte de France n’est – elle pas la carte d’état-major?
Une carte et voilà la terre surplombée, cadastrée, dominée. La carte, divine abstraction afin de prendre de la hauteur, éviter d’être englué dans la complexité du réel. Contre le regard myope, il faut le surplomb. La carte: l’œil de Dieu. J’aime à penser que la carte est née avec le langage. La même nécessité de représentation abstraite du monde. Le mot n’est pas la chose, la carte n’est pas le territoire, mais elle en livre l’accès. Toutes les cartes mènent à l’île au trésor, comme celle de Long John Silver, l’affreux pirate de Stevenson. «The villain», à prononcer avec l’accent anglais. Le méchant, si nécessaire dans la cartographie mentale de l’enfance, traversée par la ligne verticale qui sépare le Bien et le Mal, tel le Méridien divisant l’Amérique entre Espagnols et Portugais sur les cartes blasonnées du traité de Tordesillas. On peut imaginer que nos ancêtres du paléolithique avaient déjà leurs mystérieux tracés sur les parois des cavernes pour indiquer où le gibier, où la cueillette, où le danger. Cartographes, les Néanderthaliens! cartographes, les Sumériens, qui gravent sur l’argile des tablettes les premières représentations du monde, avant Erastothène, avant Ptolémée l’inventeur de la planisphère, avant Anaximandre, le plus visionnaire, avec sa carte toute ronde, comme un œil, comme une matrice, cerclée par le noir océan.
Le lent travail du dessinateur cartographe, un métier qui a disparu comme celui de meunier, de bourrelier, de sabotier, de stoppeuse de bas, de crieur public, de porteur de chaises à porteur, noyé dans le tsunami des avancées technologiques. Même si quelques-uns reviennent qu’on croyait morts, comme les cireurs de chaussures, encore prisés à l’Elysée.
Pas les cartographes. Morts et bien morts, plus raides que leurs cartons. Le monde vu d’en bas, arpenté par les explorateurs, bascule en monde vu d’en haut, balayé inlassablement par l’œil des satellites. Avec Google Earth le territoire disparaît pour devenir carte. Le monde n’a plus à être représenté , c’est-à-dire symboliquement dupliqué. Vu du ciel, il est là, en direct, il est là, à notre portée, virtuel. Le réel est devenu cette abstraction sur écran plat, disponible en deux clics. Monde carte, monde à la carte.
Les cercles de l’Enfer
Ce matin, descente au fonds ancien de la bibliothèque de Chambéry, escortée par mon aimable bibliothécaire, la maîtresse des secrets. Tandis qu’elle déverrouille devant moi une enfilade de portes, aussi blindées que la chambre forte d’une banque hélvétique, je m’imagine Dante sur les pas de Virgile, franchissant les cercles de l’ Enfer.
J’ai longtemps fréquenté les bibliothèques patrimoniales. Comme d’autres se démènent sur les pistes de ski ou les chemins de randonnée, le seul sport que je pratique avec constance est le biblio-surfing. J’ai prêté serment à La Bodléienne d’Oxford, après m’être délestée de tout ce que je portais, jusqu’au dernier stylo. Non, je ne vandaliserai pas, ne souillerai pas, ne volerai pas, les précieux ouvrages, non je n’arracherai pas des feuillets pour les cacher dans ma culotte, non je ne bouterai pas le feu à la bibliothèque. Je le jure! Une cérémonie initiatique intimidante avant l’émotion qui me submerge brutalement devant les manuscrits de William Beckford. Lettres vibrantes, écrites il y a deux siècles par un jeune homme de vingt ans. J’ai attrapé des lumbagos dans l’antique BNF, courbée sous le halo des lampes, dans la cyclopéenne salle Labrouste, à côté de vieux messieurs monomaniaques. Des années dans les bibliothèques, sans en percer le mystère. Je ne les connaissais qu’en surface, comme une invitée qu’on accueille au salon. Je n’en avais jamais sondé le silo, la réserve, l’office.
Mais maintenant j’y suis. Dans les archives. Comme Nerval, j’ai la sensation d’avoir franchi les portes de corne et d’ivoire. Me voilà parvenue au royaume des morts, au sein d’une nécropole peuplée d’âmes, tellement vivantes, de morts anciens. Je les entends doucement bruire sur les étagères, dans leurs cercueils reliés en plein maroquin. Ils restent là, debout sur la tranche, serrés les uns contre les autres, dans l’indifférence des siècles, classés non par ordre alphabétique, mais par taille. Les plus grands dominant les minus du haut de leur in-folio. Comme toujours. De loin en loin, un appelé sort du rayon, remonte à la lumière, pour être enfin tenu dans des mains tièdes, amoureuses. A la place, laissée vide, le bibliothécaire glissera une «fiche-fantôme», la bien nommée, pour remplacer l’absent, le revenant, repassé quelques heures du côté des vivants.
Les bibliothécaires sont nos fonctionnaires poétiques de l’imaginaire, un pied dans le réel, l’autre dans la bouche d’ombre qui appellent leurs fiches « fantômes ». Je pense à Nodier, bibliothécaire à l’Arsenal, à Borges, à Buenos Aires, à Umberto Eco dans la bibliothèque médiévale de l’Université de Bologne , je pense à Smarra, au Livre de sable, à la bibliothèque de Babel, au Nom de la rose. Le fantastique a partie liée avec la bibliothèque.
Emboîtements d’échelles
Toute l’Afrique est là, en Savoie. Une somme prodigieuse de cartes, de lettres, de récits de voyages. Launay de Bissy a tout conservé. Articles de presse où l’on peut suivre au jour le jour les expéditions des puissances européennes. Leurs rivalités. Riches heures du colonialisme conquérant. La petite Belgique en passe d’annexer le gigantesque Congo. La couleuvre a avalé l’éléphant. «Le mouvement géographique de Bruxelles» donne des nouvelles des voyageurs, les «Nouvelles du Congo» sonnent le clairon. Triomphalisme et «story telling» avant la lettre. La colonisation comme récit d’aventures. Des titres d’articles pour embarquer le lecteur jusqu’à la dernière ligne – habilement suspendue - du feuilleton. La suite au prochain numéro. «Aventures du capitaine Hanssens», «On avance sur toute la ligne», «Au pays des Bangalas», «Toujours devant!»
Il faut imaginer ces bourgeois ventrus de la IIIème république, ces assis à rouflaquettes, courir les déserts, tailler leur chemin dans la brousse, sans cesser de faire «corps avec leurs chaises». Par la seule magie du récit de voyage. Le récit de voyage comme aventure par procuration. Mieux! Comme rédemption! Chaque voyageur est un héros et un prophète. Le voyageur est le voyant, à une voyelle près. Il est celui qui a vu et qui donne à voir. L’étonnant voyageur de Baudelaire.
En la matière, Lannoy a percolé toute la bibliothèque. Pas un récit de voyage ne lui a échappé. Je lui fais confiance, maintenant qu’on se connait. Un territoire seul me retient, d’une manière instinctive, l’Abyssinie où je n’ai jamais mis les pieds mais qui m’inspira mon premier roman, La servante abyssine. Je ne la connaissais que de loin, de Djeddah où je vivais à l’époque. J’en respirais l’haleine, les jours où le khamsin couvrait tout d’une poussière rougeâtre, venue des côtes d’Afrique. Je la devinais. Parfois je lui donnais une silhouette, les corps élancés des travailleurs Erythréens sur le chantier; un visage d’or brun, celui d’une servante délurée au regard étincelant. Mais maintenant j’y vais, je saute le pas, c’est-à-dire la Mer Rouge. Je vais suivre Lannoy dans ses explorations. A sa façon peinarde, sans prendre de risques, sur des sentiers de papier.
Un ascenseur me ramène du côté des vivants dans la salle de travail, avec ma moisson de documents et quelques ectoplasmes passés en contrebande. Un plein chariot de cartes, de récits de voyage, des cahiers manuscrits. Compilations des lectures de Lannoy, entre la fiche et le reader-digest. Wikipédia avant la lettre. Je m’émerveille une fois de plus des capacités de travail – de masochisme - du Colonel, forçat de la cartographie.
Deux cavaliers dans le Choa
Dans les hampes de l’écriture aristocratique de Lannoy, je tombe sur le résumé du voyage de Borelli: «Ethiopie méridionale, journal de mon voyage au pays Amhara, Oromo et Sidama (septembre 1885 à Novembre 1888)». Une connaissance! Jules Borelli, l’explorateur, le compagnon de voyage de Rimbaud à travers le Harrar. Lannoy note l’arrivée à Toudjourah le 9 février de M. Rimbaud, négociant français. Sans plus. Sans se douter, comme tous ceux qui le rencontrèrent en Orient, comme Borelli lui-même, qui passa des mois avec Rimbaud, à partager le même bivouac, les mêmes fatigues, les mêmes dangers, sans s’imaginer un instant qu’il côtoyait le génie précoce de la littérature. Dans cet épicier qui trafique des fusils, personne n’a vu le «passant considérable» de Mallarmé. Epoque où Rimbaud n’est pas Rimbaud, seulement un négociant français, expérimenté, consciencieux, apprécié par ses employeurs, mais tenu à distance par les Européens qui le trouvent bizarre, se méfient de ses sarcasmes. Voyons voir, que dit Borelli de cette rencontre du 9 février 1887? «Notre compatriote a habité le Harrar. Il sait l’arabe et parle l’amhariga et l’oromo. Il est infatigable. Son aptitude pour les langues, une grande force de volonté et une patience à toute épreuve le classent parmi les voyageurs accomplis.»
Ce que Borelli ne dit pas, c’est que sans Rimbaud il n’aurait pas pu effectuer ce voyage. Son entreprise scientifique n’était pas prise au sérieux, le roi Ménélik ne lui aurait jamais donné l’autorisation de le faire seul. Rimbaud devait acheminer des armes à Ménélik, la caution était suffisante. Et les voilà partis de concert, les deux cavaliers dans le Choa, le marchand d’armes et le géographe. Au fond, Borelli est le scientifique, l’explorateur que Rimbaud aurait voulu être, mais il est condamné à son désespérant négoce. L’argent, les thalers Marie Louise, qu’il faut convertir en or et planquer dans cette ceinture qui lui scie les lombaires!
Il n’est pas le fils de Vitalie Cuif pour rien. Ses lettres à sa famille ressemblent à des carnets de dépense, ponctués de de lamentations. «Les années passent et je n’amasse rien, je n’arriverai jamais à vivre de mes rentes dans ces pays».
Ce voyage aura ravivé des velléités scientifiques chez Rimbaud. L’été suivant, de passage au Caire, il enverra au «Bosphore égyptien», journal francophone, dirigé par le frère de Borelli, un long article sous forme de lettre pour rapporter ce voyage. Ni poésie, ni exotisme, des descriptions pratiques, du factuel et surtout une étude sur l’intérêt économique du Choa et les possibilités d’une ligne de chemin de fer. Seulement, ici et là, quelques sonorités noires, l’adjectif «horrible» qui revient, lancinant: «routes horribles», «cloaque horrible». On ne sort pas de la Saison en Enfer.
Borelli, plume de Rimbaud! Il écrit et publie en 1891 le livre que Rimbaud n’écrira pas, ce monumental journal de voyage illustré de dessins au fusain. Au départ, une multitude de photos, prises sur le vif. Portraits de femmes Danakils aux coiffures pharaoniques, de guerriers au regard inquiet, villages étagés aux toits de chaume, semblables à des chalets, dans la verdure de la «Suisse africaine». Borellli fait dans le pittoresque, des chromos pour Européens en mal d’exotisme. Je ne peux m’empêcher de penser qu’il donne à voir ce que Rimbaud a vu. Les photos qu’il a prises sont celles que Rimbaud aurait pu prendre. N’avait-il pas commandé à sa mère un coûteux appareil photographique? «Si je veux, je regagnerai vite les 2000 francs qu’il m’a coûté. Tout le monde veut se faire photographier ici» Une nouvelle carrière de photographe colonial! «La science, la nouvelle noblesse! Le progrès» Peut-être y croit-il sous le sarcasme. Les illuminations naîtront de la chambre noire, il faut «être résolument moderne». Etranges photos! Instantanés de la douleur, immortalité de l’ennui. Cet autoportrait, un visage dur de bagnard, les bras croisés sous le bananier, en camisole et pantalon blanc. «Le forçat intraitable sur lequel se referme toujours le bagne». Le bagne se referme sur sa carrière de photographe. Son projet d’expédition photographique au Choa sombre dans la faillite de son patron, Bardey. L’appareil photo est vendu, le livre sur Le Choa, destiné à la société de géographie de Paris ne se fera pas. Ou plutôt, c’est Borelli qui le fera. Et le voilà, escortant ce géographe marseillais qui lui vole les images qui étaient les siennes, qui dessine sa carte.
CARTES SANGLANTES
Cartes sur tables. Elles sont là devant moi, sur la table de la bibliothèque, ces cartes de Borelli sur papier calque de couleur bronze, papier pelure, translucide comme une peau humaine. L’itinéraire tracé à l’encre rouge, de Tadjourah à Antototo et retour par Zeyla, chemin de sang sur une peau brune. Scarifications rituelles. Le fil rouge incise le territoire. Au nord, le pays Afar des Danakils, au sud, le pays Somali des Issas, les peuples ennemis. Entre les deux, le chemin, jalonné de petits ronds, des villages, méticuleusement nommés. Comme le Yavhé de la Genèse, le cartographe nomme le lieu, afin que le territoire soit. L’appropriation par la toponymie. Et la terre parle. Elle se livre, elle murmure ses noms aux sonorités rauques: Zargé, Tchorra, Arawa, Harrar, Walisso, le volcan Zoukouala et la rivière Aouache. Multitude de noms vrombissant comme des mouches sur la carte. Ils ne seraient pas à faire tout ce ramdam, si Rimbaud ne les avait pas d’abord prononcés, en prenant soin de bien articuler, afin que Borelli les écrive. Chaque soir, au bivouac, le cartographe prend des notes, transcrit les toponymes sous la dictée de ce blanc taciturne qui parle plusieurs langues d’Ethiopie, après avoir renoncé à inventer la sienne. Lui qui, à l’époque de la lettre du voyant, s’acharnait à «Trouver une langue», voilà qu’il en trouve plusieurs. Langues «nègres», poétiques parce qu’étrangères, encore lestées d’inconnu. Arabe, Ahmariga, Orhomo, Il les apprendra patiemment, avec tout son sérieux d’ancien premier prix de version latine.
Cette carte, Rimbaud en est le co-auteur, il l’a faite, comme il a fait la route, l’aller et le retour entre Harar et la côte. Des dizaines de fois. Mais la dernière! Oh! la dernière! Juin 1891, quinze jours de voyage porté par treize hommes, sur une civière dessinée par ses soins, avec une toile en forme de dais pour le protéger du soleil. Prince de misère, la jambe raide et le genou comme une calebasse, du sang séché aux cailloux du chemin. Cette carte, il la voit encore de son lit de mort à Marseille, il suit la route sanglante une dernière fois et il refait le chemin inverse: Toudjoura, Ankober, Harar, 1976 mètres d’altitude, noté à l’encre rouge par Borelli. Il suit sa carte mentale, Il y retourne. Il rêve de repartir. La veille de sa mort, dans son délire ultime, il écrit au directeur des Messageries maritimes: «Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord?». 10 novembre 1891: pas de suite au prochain numéro.