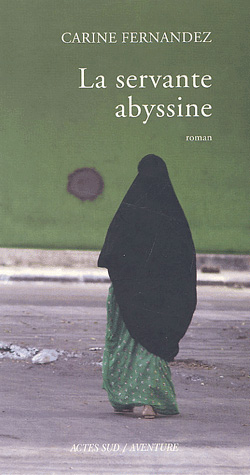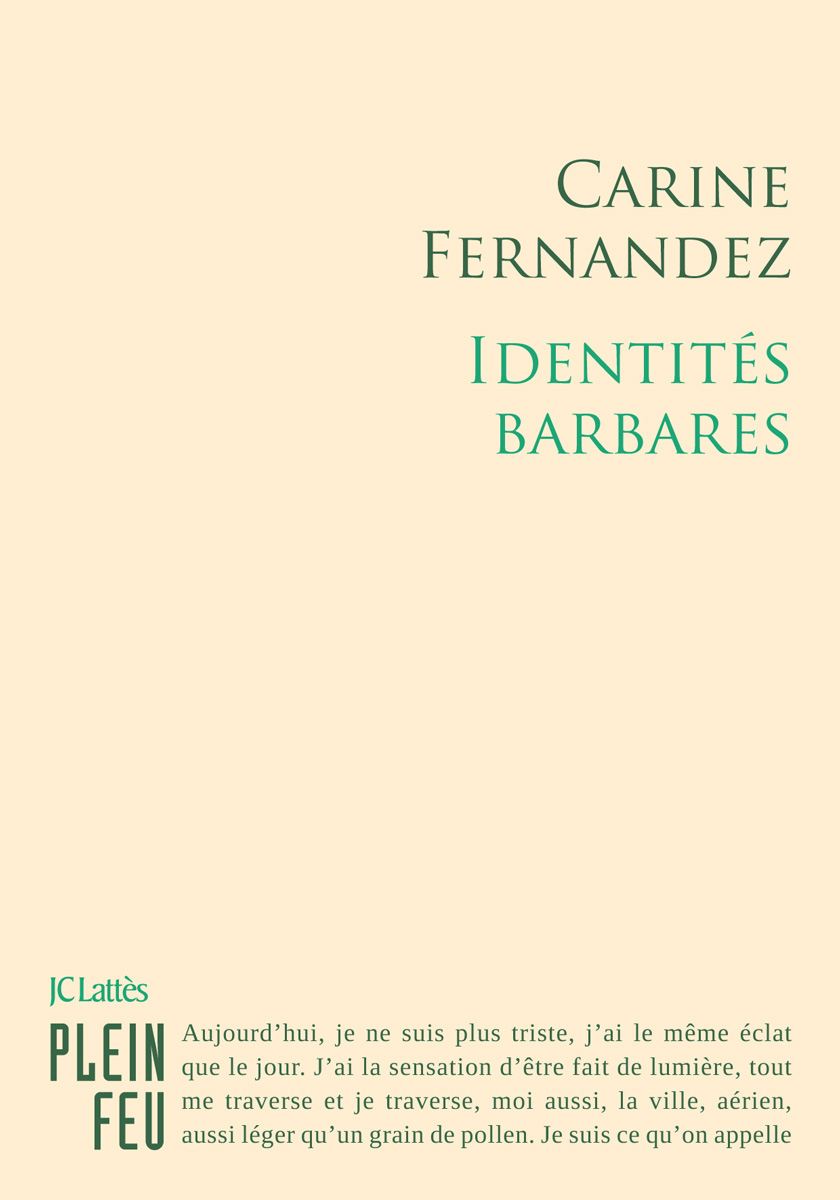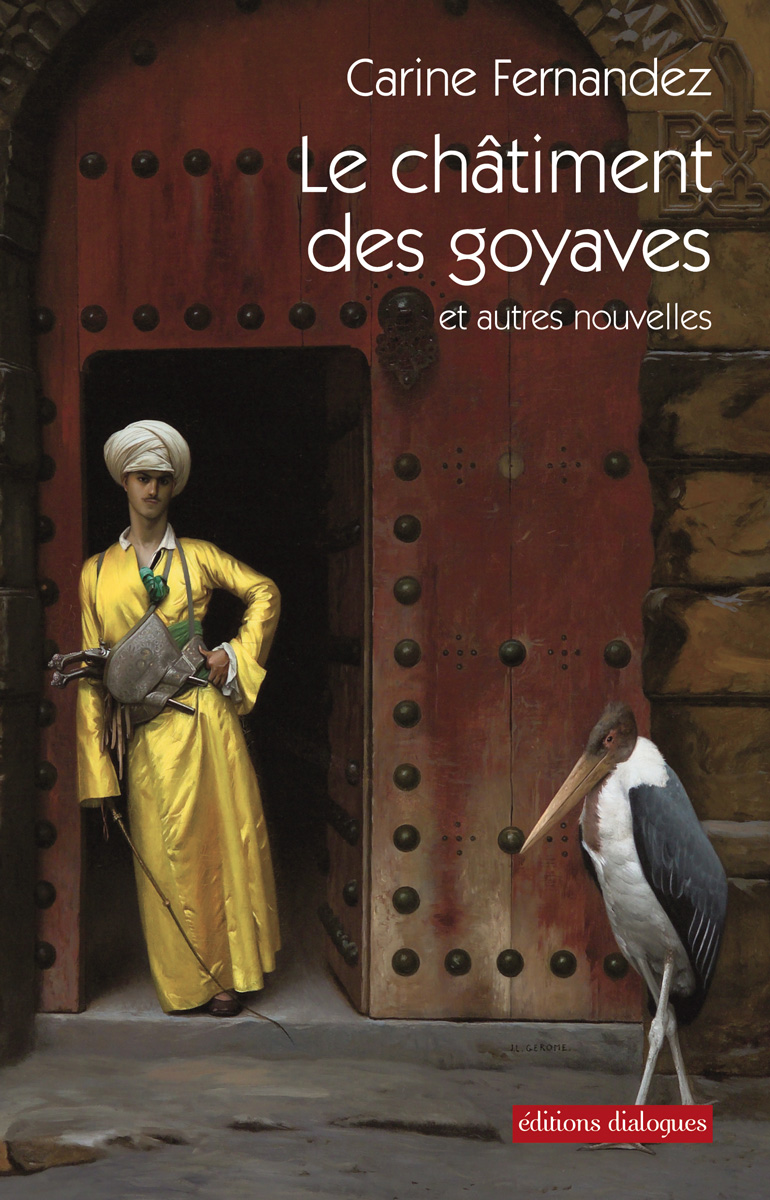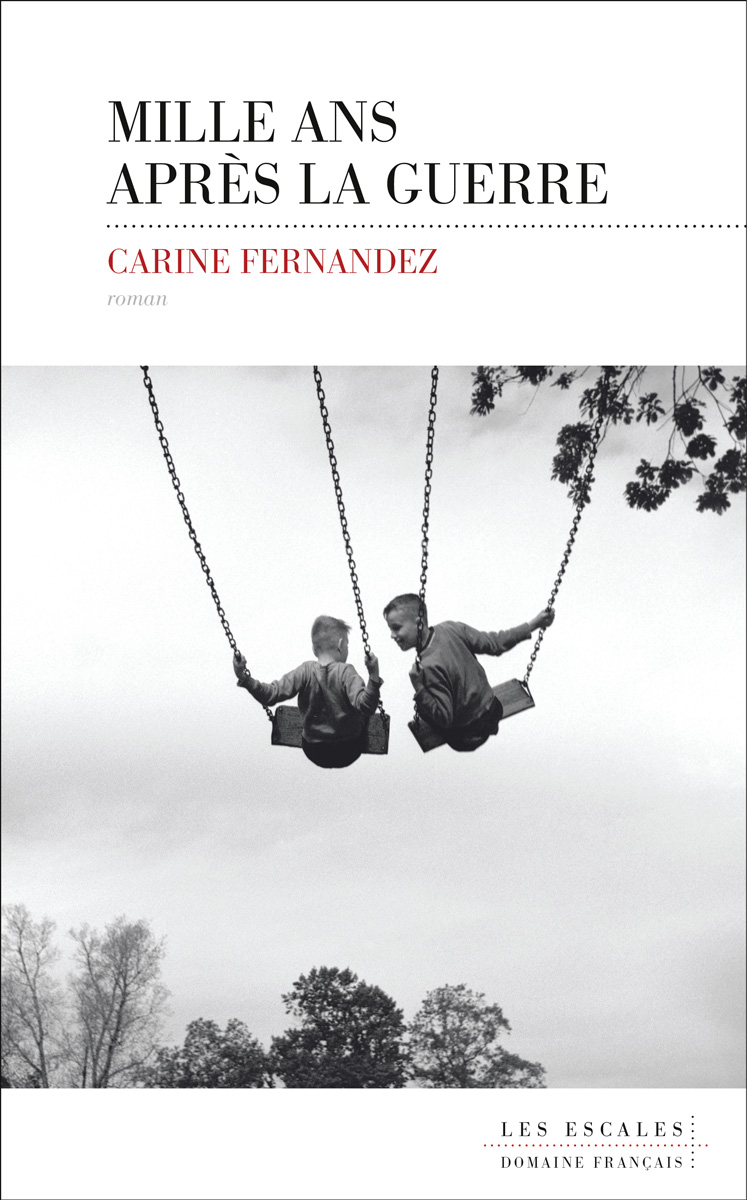Dans le lazaret lyonnais
Les écrivains en confinement
Entrée principale du lazaret de Port Mahon (îles Baléares)
Lazareto Island, Port of Maó, Menorca © MontanNito
Après une première vie aventureuse et honteusement romanesque (elle s’enfuit à seize ans en Orient d’où elle ne reviendra que 20 ans plus tard), elle s’est sédentarisée dans la région lyonnaise. Elle a publié 7 livres, chez Actes Sud, J.C. Lattès, Les Escales ; toujours le nomadisme, éditorial cette fois. Mille ans après la guerre (Les Escales 2017), couronné notamment par le Prix Henri de Régnier de l’Académie française et le prix Lettres Frontière, a été traduit en espagnol. Son dernier roman Un jardin au désert (Les Escales 2019) est une fresque familiale échevelée dans l’Arabie contemporaine. Également poète elle a publié en 2019 Les routes prémonitoires aux éditions La Passe du vent. Carine Fernandez est titulaire d’un doctorat d’état de littérature du XVIIIème sur Vathek de Beckford, ce qui est la manière la plus monomaniaque de perdre son temps. Elle a l’âge qu’elle a.
« Ça alors ! Tout le monde s’est mis à vivre comme moi ! Les humains ont regagné leur tanière, sommés d’hiberner au temps des cerisiers en fleurs. Le confinement planétaire me laisse totalement ébaubie. Moi qu’on taxait d’anormale, d’asociale, de solitaire, de misanthrope, d’ermite et plus affectueusement d’oursonne. Moi qu’on enjoignait de changer, de m’adapter au rythme du monde, voilà que le monde entier s’est adapté au mien ! Le Covid 19 fait vivre la planète au rythme des écrivains … et des phobiques sociaux !
« Confinement », encore un euphémisme, un de ces lâches éléments de langage pour ne pas dire ce que les Espagnols appellent franchement l’enfermement : « el encierro ». Je l’appellerai quarantaine, en espérant qu’elle n’excédera pas ce chiffre. Pas tellement pour moi, pour qui ça ne change pas grand-chose. Mais pour les autres, ceux que j’aime – et même ceux que je n’aime pas – et aussi pour tous ceux que je ne connais pas et qui se sont mis à me ressembler. Mes frères humains, si lointains, si proches tout à coup. Et nous voilà conscients de faire partie d’une même espèce, susceptible de choper le sale virus, et qu’on enferme. Tandis que les bêtes sont plus merveilleusement libres qu’elles ne l’ont jamais été. Nous savons maintenant que nous ne sommes pas des bêtes, le Covid19 a reconnu les siens.
L’enfermement, le « rester chez soi », je dois dire que j’ai un entraînement olympique pour la discipline. La bibliothèque a toujours été ma première patrie, le canapé la seconde. Je suis binationale. Et pour avoir vécu des années en Arabie Saoudite où la clôture n’était pas un vain mot, j’ai plus de résistance au confinement qu’un cosmonaute de la NASA. Le port du masque et la distanciation sociale aussi, je connais. Mais ces mesures de précaution étaient là-bas réservées aux femmes.
Avril 2020 – Je suis seule dans mon appartement à l’Ouest de Lyon ; j’ai toujours été à l’ouest. Le soleil est mon ami et l’écureuil qui grimpe cinq étages pour venir me saluer sur mon balcon. L’écureuil est mon ami, mais pas l’ascenseur ! L’ascenseur est un monstre couvert de boutons sournoisement infectés. Et l’escalier en colimaçon où l’on risque de buter sur d’autres pesteux confinés n’est pas mon ami non plus. J’aimerais avoir des ailes comme les corneilles qui font des loopings dans un ciel bleu sans avion (tiens, ça pourrait faire un chouette nom de couleur : le « bleu sans avion »).
A part ça, la vie en quarantaine ne change rien pour moi. Si ce n’était mon inquiétude pour mes proches, désormais si loin, je serais plus heureuse que Saint Antoine au désert. Lui devait résister, le pauvre vieux, seul avec son cochon, à toutes les tentations du diable. Mais le diable n’est plus polymorphe, il ne se cache plus sous les courbes affriolantes des succubes, le démon a pris la forme d’une boule microscopique hérissée de picots qui vous saute au visage.
A l’époque des saints et du démon, il y avait le Monde, antinomique de l’ermitage. Le monde et ses tentations, versus la clôture. Eh bien ! C’est terminé ! Depuis la quarantaine, le monde n’existe plus. On nous a privés de l’extérieur. Plus le droit de voyager, visiter, randonner, musarder. Mais qui aurait encore envie de voyager dans des contrées vides d’humains, atrocement ? Le monde nous est interdit, dès lors il n’existe plus pour nous. Peut-être pas si fou, l’ami Berkeley qui niait l’existence du réel. Si on ne le voit pas, c’est que le réel n’est pas, disait l’allumé philosophe. Ça s’appelle l’immatérialisme. Une doctrine à laquelle on va tous finir par se convertir.
Que fabrique donc la nature depuis que l’homme lui a foutu la paix ? Une grande première depuis des millénaires. Et je me demande si, en l’absence d’humains, les montagnes et les forêts, les rivages et les océans, les fleuves et les prairies n’ont pas tout simplement cessé d’exister.
Le monde vrai, celui que nous habitons, s’est singulièrement rétréci aux limites de l’appartement, et lorsque par extraordinaire, nous sortons, nous marchons dans un cercle invisible qu’on appelle distance de protection. Les caissières nous craignent autant que nous les redoutons. Notre mort, la nôtre que nous ne nous connaissons pas, aura peut-être le regard las de cette femme qu’on envoie sur le front en première ligne.
Alors on ne s’attarde pas dehors. On rentre chez soi en loucedé et on désinfecte ses courses comme si on sortait de Tchernobyl. Et on cuisine.
Pas moi ! Je ne fais pas de soupe, je ne mitonne pas et j’ai longtemps appelé Picard : bienfaiteur de l’humanité. Je ne veux pas engorger davantage les hôpitaux en courant le risque de faire des cookies (souvenir d’une ou deux galettes plus cramées que Saint Laurent sur son grill.)
Non, je ne sais rien faire de mes dix doigts, hormis tourner des pages et taper sur un clavier. Deux activités qui ne nécessitent pas de planning pour « structurer » ses journées. Je vis et j’écris à l’instinct, en suivant ma pente, de manière quasiment animale (si les bêtes écrivaient…). Les bêtes n’ont pas besoin de planning pour savoir quand chasser, manger, baiser, dormir.
La bibliothèque est là. Mon terrain de chasse. Je lis dix livres en même temps. Je prends, je jette, je les flaire comme le chat que je n’ai pas. Trois coups de stylet de Cioran, deux chapitres de Stendhal. Après la rage jouissive de Thomas Bernhard, j’ouvre Robert Walser et d’un coup le jour redevient féérique et l’homme bon. Mais Walser était fou n’est-ce pas ? La littérature est une maladie mentale.
On se croirait revenu au 18ème siècle où s’opposaient les théories sur la propagation de la peste. Par contact ou par aérosols ? On en est là ! Humanité désormais masquée. Nous voilà condamnés à croiser des fantômes, sans visages. Cette rencontre des visages qui était pour Lévinas le signe de reconnaissance de l’humanité de l’autre. Bientôt le masque obligatoire. Seuls les yeux où se réfugie la peur.
Non, décidément, le monde réel n’est pas sérieux ! Seule la fiction est encore crédible.
Alors, pour survivre, il ne nous reste plus que l’écriture, comme Flaubert, confiné volontaire à Croisset, il nous faut « niaiser et fantastiquer ».
Finalement nous vivons une quarantaine inversée. Autrefois le lazaret était ce lieu d’enfermement où l’on mettait les voyageurs en quarantaine afin de préserver le reste du pays, aujourd’hui chaque foyer est devenu lazaret. Home sweet lazaretto !
Par une ironie du sort que les Anglais appellent joliment poetic justice, le roman auquel je travaille depuis un an est un récit picaresque qui se déroule en 1800 à Minorque, dans … le lazaret de Mahon ! J’espère que j’en viendrai à bout. Je n’ai jamais écrit aussi lentement, les montres et les horloges sont devenues plus molles que celles de Dali, marquant les heures distendues d’une autre temporalité : le temps du Coronavirus. Je suis comme nous tous, « hors de moi », la cervelle évaporée depuis le début de ce coup d’état sanitaire mondial. Et j’avoue que voir ma fiction rattrapée par le réel m’a passablement plombé le moral. Roman maudit dont le titre me chante dans la tête depuis longtemps : L’amour au lazaret.
Quand je présentai le projet, on me le déconseilla. « Tu sais, la peste, de nos jours ça n’intéresse plus grand monde. Tu devrais écrire quelque chose de plus actuel ».
Plus actuel ? »