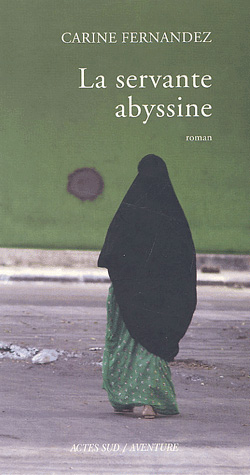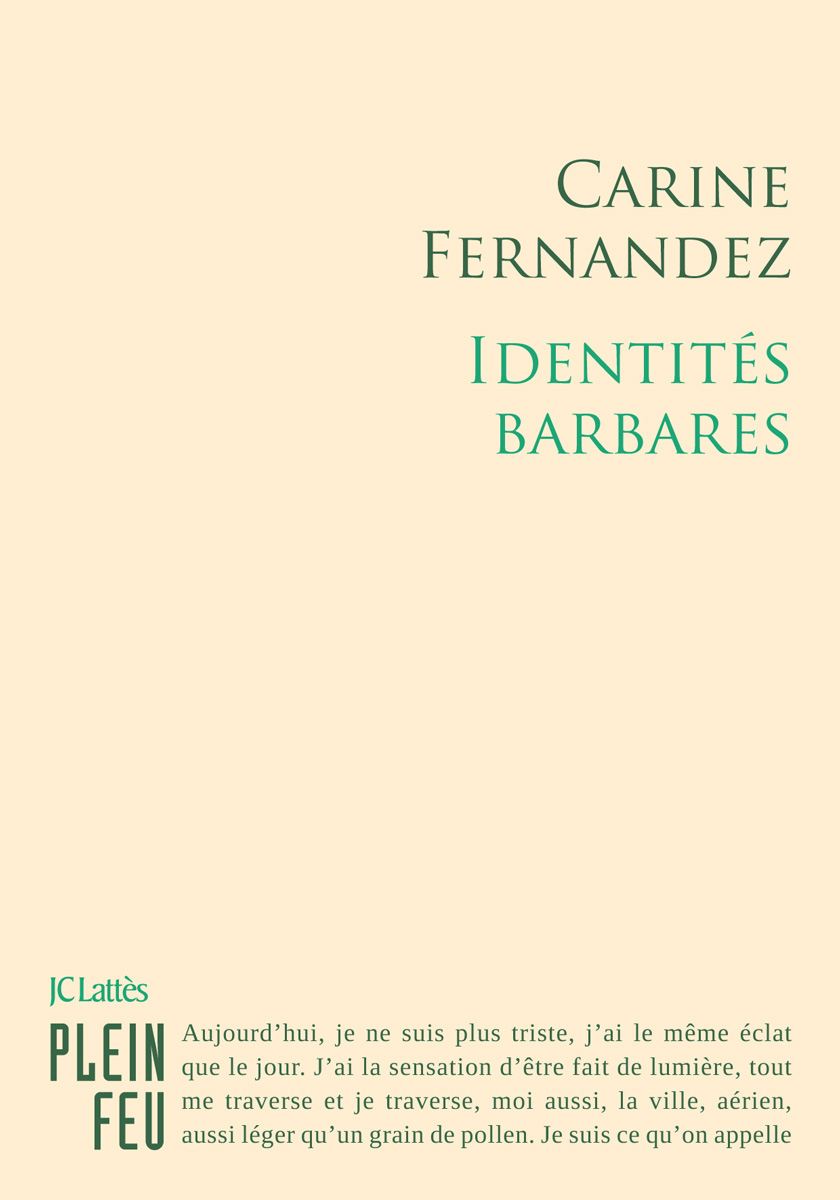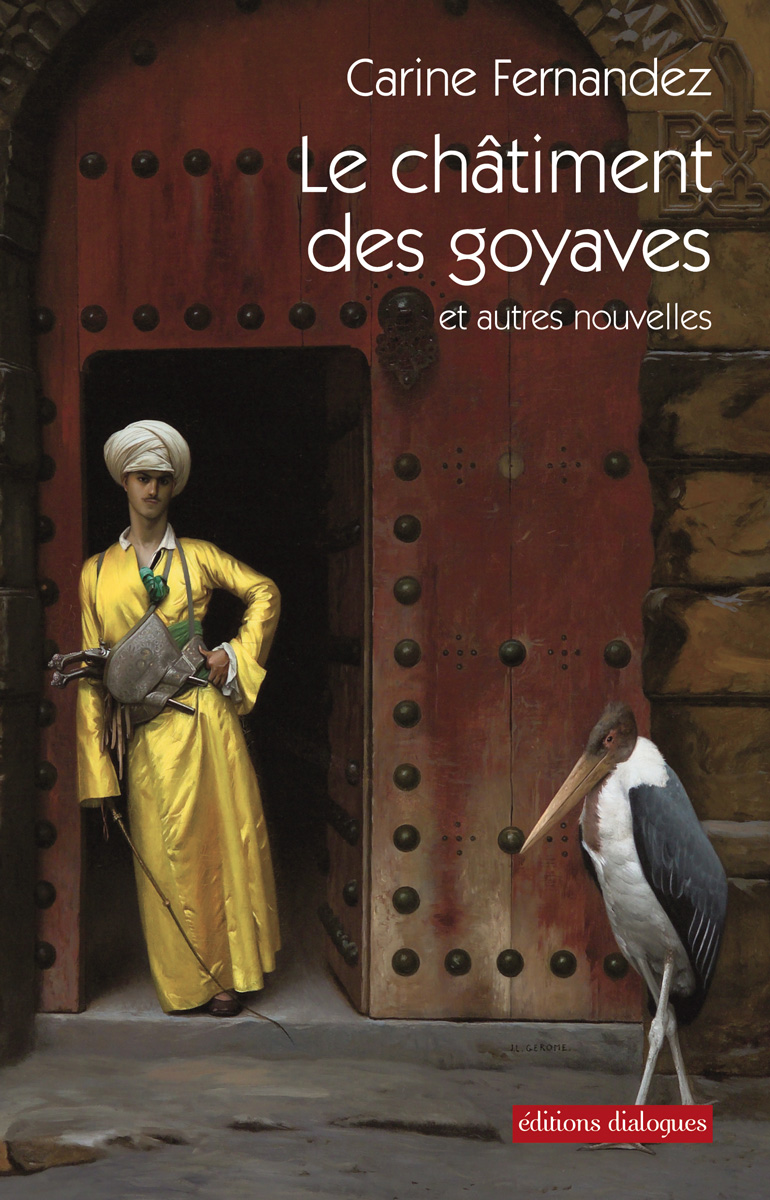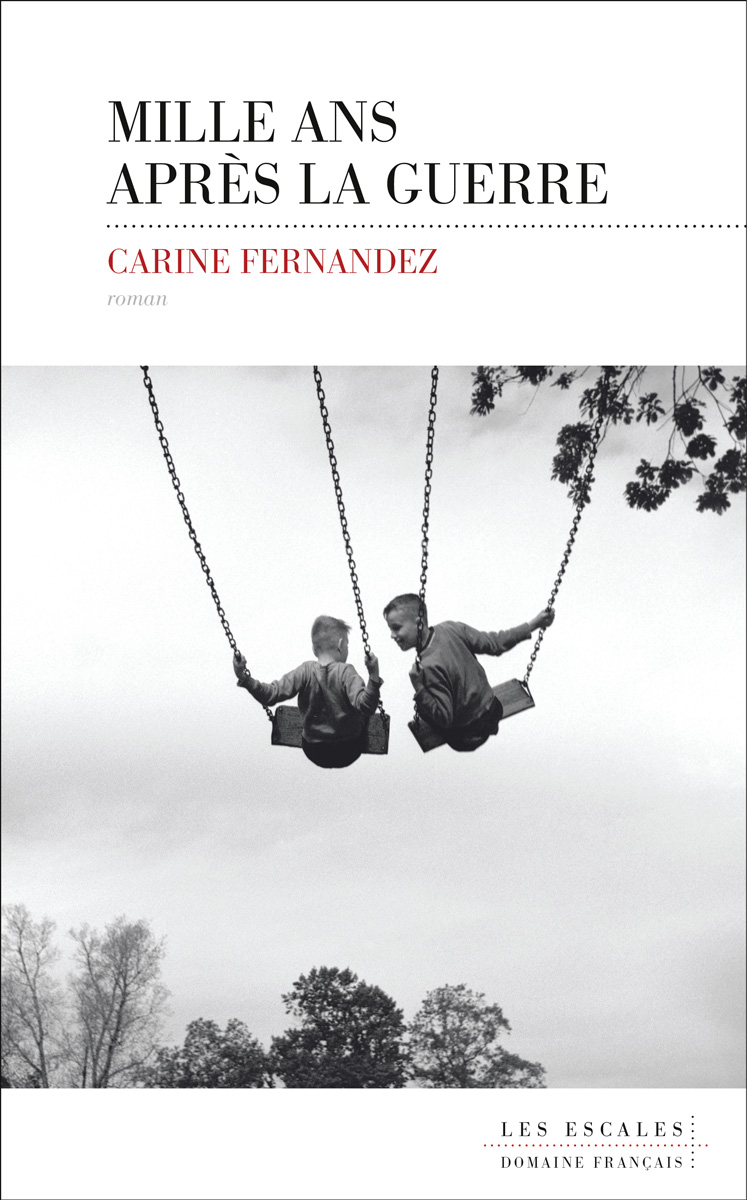La frontera
Cliquez pour agrandir
 La frontera
La frontera
Éditions Lettres frontière
Publié en 2013 dans un ouvrage collectif à l'occasion des 20 ans de Lettres frontière.
Je ne l’ai d’abord entendu appeler que frontera. Elle se tenait, terrible, entre la France et l’Espagne, comme un de ces démons qui jettent l’épouvante, non seulement dans l’esprit des enfants, mais des grandes personnes. Puisque mon père n’en parlait qu’avec un frisson dans la voix.
La frontera c’était le lieu mystérieux où il nous conduisait dans la voiture surchargée de valises, maman, mes frères et sœurs et moi pour nous mettre dans le train. Gare de Cerbère. A dix ans, j’imaginais le monstre qui gardait les enfers. Et il devait bien y avoir l’enfer de l’autre côté de cette ligne interdite que mon père n’avait pas le droit de traverser. Il s’en retournait seul après d’ultimes recommandations: on donnerait à ses sœurs ces lettres enluminées de dessins et de poèmes, on saluerait sa mère, la tombe de sa mère et on n’oublierait pas de lui rapporter le fromage Manchego et le pain. Surtout le pain, lourd et blond, pareil à sa terre que lui, l’impie, l’iconoclaste, mangerait religieusement, découpant de fines tranches de son canif comme s’il s’incorporait l’âme de son pays.
Et après le départ du train, il reprendrait le volant pour rôder encore sur les petites routes des Pyrénées, longeant autant qu’il pouvait l’interdite frontière, avant de remonter à Lyon. Car je compris très vite que de l’autre côté commençait la terre de mon père, et qu’elle lui était, à lui seul, interdite. Il lui fallut attendre que Franco amnistie les prisonniers politiques en 70 pour y retourner.
De l’autre côté de la frontière, c’était un autre univers. La terre était plus rouge, plus âpre, la lumière plus intense, les couleurs exaspérées comme des piments, les sons résonnaient autrement dans la riche vocalisation de la langue. Et les odeurs! Les yeux fermés pour humer violemment le grand corps de l’Espagne, parfum rauque de ciste sec et goulées fraîches des cafés sombres comme des puits sous les arcades,qui sentent l’anchois et l’anisette et le carrelage lessivé à grands seaux d’eau. Sans doute, les humains étaient autres de l’autre côté de la frontière. La traverser le temps des vacances, c’était pénétrer dans l’étrangeté même, le dernier bastion des dictatures fascistes, l’Espagne franquiste. Qu’on se le dise! c’est pourquoi elle était gardée par des hommes en armes vêtus de vert dont les incroyables casques en celluloïd, entre le chapeau de torero et celui du Jedi de la guerre des étoiles, jetaient des éclats noirs: la guardia civil aussi terrifiante que dans les poèmes de Lorca.
C’était une frontière fermée, armée, faisant face à l’ennemi, au sens étymologique du terme: le front. J’en ai passé tant d’autres depuis, dont je conservais orgueilleusement les coups de tampon sur mes passeports comme autant de trophées: Liban, Jordanie, Syrie, Egypte, Arabie. Ce Moyen Orient couturé des frontières politiques laissées par la chute de l’empire ottoman. Ça a beau être la même langue, la même culture, cousinages belliqueux cependant. Querelles de famille.
Frontières défensives, bouclier levé contre l’autre, le frère maudit. Chacun voit Caïn derrière sa frontière.
Se peut-il que la frontière soit inscrite profondément et de manière indélébile dans notre humanité? Que la frontière soit ce qui nous fonde, limite et matrice à la fois? Enceintes de pierres, de fer ou de béton armé, grande muraille de Chine, murs de Berlin, de Gaza, du Mexique, barrages contre l’immigration, murs de la peur, murs de la haine, murs de la honte. La frontière, scarifiée sur le sol, sur les cartes et jusque dans les toponymies.
Juillet 2013, je suis à Palos de la Frontera, dans cette Andalousie où le mot «frontera», régulièrement accolé aux noms des bourgades - Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Vejez de la Frontera – rappelle la reconquête obstinée, poursuivie au fil des siècles. Les Maures repoussés au-delà d’une ligne toujours mouvante, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à reconquérir: 1492, chute de Grenade. Enfin chez soi. Entre Espagnols. Isabel et Ferdinand, les rois catholiques. Mais voilà, la même année, il y eut Colomb et la conquête de l’Amérique, nouvelle frontière, non plus dans le sens de refuge mais d’ouverture, confins du monde sans cesse repoussés. Colomb, parti du petit village de Palos de la Frontera après sept ans de tractations pour convaincre Isabel. Cette fois la reine ne s’était pas mis les mains sur la tête en lui disant «Ay! Colomb, tu es fou, retourne d’où tu viens!». Non elle lui avait accordé le dinerito, restait à trouver l’équipage, des hommes assez cinglés pour s’embarquer avec lui dans cette aventure suicide. Pensez, le bout du monde pour ces matelots ignares, plus habitués au maniement de la charrue que de la grand voile, tremblants à l’idée que la mer brusquement s’arrête et dégringole en une cosmique cataracte, puisque bien sûr la terre était plate comme une hostie!
Palos de la Frontera oublié de l’histoire, le village du prodige, le port minuscule qui a découvert le nouveau monde et d’où la mer s’est retirée. La crique, à présent ensablée, n’abrite plus qu’une station service à l’emplacement précis où étaient amarrées les trois caravelles.
C’est là, qu’après avoir visité le monastère de la Rabida qui hébergea Colomb, je fais le plein, en pensant aux marins qui y firent l’aiguade avant de partir. Ce soir, à la terrasse d’un café, j’attends que la vraie nuit s’installe avec ses étoiles rieuses qui sentent le jasmin et sa pleine lune de Ramadan. Le même ciel qui salua Colomb, un ciel au-delà des frontières et du temps. Vers minuit des autocars de ligne déchargent leurs cargaisons de passagers aux yeux las.
Commence alors une noria d’arrivées et de départs qui durera une partie de la nuit. Pas des touristes étrangers, ni des voyageurs espagnols, ces hommes et ces femmes, jeunes pour la plupart qui s’éloignent d’un pas chancelant, ankylosés par les trois jours de car, ce sont des travailleurs roumains. L’Espagne en crise reste encore l’Eldorado des miséreux de l’Est qui sarclent les champs, cueillent les fraises, servent dans les bars pour une poignée d’euros.
Il fallait que les frontières intérieures de l’Europe s’effacent pour que ce patelin devienne leur dernière frontière. La pointe extrême du vieux continent n’est plus le promontoire, la rampe de lancement vers le nouveau monde, mais la destination ultime de ceux qui n’ont plus rien. Le retour de bâton sarcastique de l’histoire, ce que les Anglais appellent poetic justice. Mais Palos ne signifie-t-il pas bâton? Sur les autocars rouges l’inscription Bucarest- Roma- Genova -Palos épaterait bien Colomb, le Génois!